Maltraitance infantile : quand le cerveau révèle les mécanismes de la résilience face à la dépression
17 février 2026


Transporter un médicament dans l'organisme et l'amener jusqu'à une cible précise : tels sont les défis de la nanomédecine. Les premiers nanomédicaments sont apparus il y a 10 ans contre le cancer et font l'objet de nombreuses études. La recherche offre aujourd'hui de nouvelles perspectives, l'idée étant de pouvoir étendre ces thérapies à d'autres pathologies.
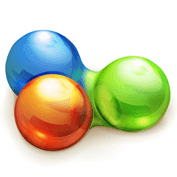
« Un nanomédicament est une molécule thérapeutique contenue dans une particule mesurant entre quelques dizaines et quelques centaines de nanomètres [soit un million de fois moins qu'un millimètre] », explique Patrick Couvreur, spécialiste de la nanomédecine.
Cette nanoparticule protège le principe actif du médicament d'une éventuelle dégradation. « On peut aussi désormais modifier la surface de la nanoparticule pour lui permettre de se lier uniquement à certaines cellules malades, un peu comme une clé dans une serrure », décrit Patrick Couvreur.
Avantage par rapport à un médicament classique : une action plus ciblée et, a priori, moins d'effets secondaires.
Nanomédicaments de 1re génération
Ils reposent essentiellement sur l'utilisation d'un type de nanoparticule appelé liposomes. Les liposomes sont des petites vésicules dont la membrane est constituée par une double couche de lipides. Le principe est le suivant : ces nanomédicaments sont injectés par voie intraveineuse et sont alors identifiés par l'organisme comme des corps étrangers. En réaction, l'organisme va les recouvrir par des protéines indiquant clairement leur identité de « corps étrangers » afin qu'ils soient captés par le foie. C'est un moyen efficace de traiter certaines maladies du foie en y amenant directement les médicaments.
Nanomédicaments de 2e génération
Ils utilisent des polymères hydrophiles (matériaux ayant une affinité particulière avec un milieu liquide) qui sont fixés à la surface des nanoparticules. Conséquence : ils sont moins reconnus comme étrangers par l'organisme et circulent dans le sang plus longtemps (on dit qu'ils sont « furtifs »). Ce type de médicaments peut ainsi être utilisé pour le traitement des tumeurs cancéreuses. « Les nouveaux vaisseaux sanguins formés par une tumeur sont plus poreux que des vaisseaux sains, explique Patrick Couvreur. Les nanomédicaments traversent donc plus facilement la paroi de ces vaisseaux et réussissent ainsi à atteindre les cellules malades. » Plus gros qu'une simple molécule, les nanomédicaments sont retenus plus longtemps au sein de la tumeur, ce qui prolonge leur action.
Nanomédicaments de 3e génération
Actuellement en développement, ils sont recouverts de molécules qui permettent un ciblage spécifique. En fonction de ces molécules, les nanoparticules reconnaissent un type de cellule cancéreuse ou un agent infectieux donné et lui délivrent alors le médicament qu'elles contiennent.
Une dizaine de nanomédicaments sont déjà sur le marché, la plupart en cancérologie. La doxorubicine enfermée dans des liposomes est une chimiothérapie utilisée contre certains cancers du sang ou de l'ovaire. Le paclitaxel contenu dans des nanoparticules d'albumine est, quant à lui, utilisé dans les cancers du sein, du poumon et du pancréas. « Un essai clinique de phase 3 [derniers tests avant la commercialisation du traitement] est en cours avec des nanoparticules biodégradables développées par mon équipe, explique Patrick Couvreur. Ces nanoparticules encapsulent de la doxorubicine pour traiter un cancer primitif du foie. Les résultats de la phase 2 [qui évalue l'efficacité du traitement] avaient déjà montré une chance de survie multipliée par deux pour les malades, 18 mois après traitement, par rapport au traitement standard. » D'autres chercheurs mettent au point des nanoparticules magnétiques, capables de s'associer à certaines cellules cancéreuses. Une fois ces nanoparticules fixées dans la tumeur, elles sont stimulées par un champ magnétique externe. Ce phénomène permet d'augmenter la température sur la zone concernée et ainsi de détruire les cellules cancéreuses.
Les scientifiques cherchent aujourd'hui à améliorer l'efficacité des nanomédicaments. « Les techniques actuelles ont un taux d'encapsulation [taux de molécules enfermées dans la nanoparticule] assez faible : il faut beaucoup de nanoparticules pour finalement n'y encapsuler qu'assez peu de molécules actives (ou médicament) », explique Patrick Couvreur, dont l'équipe travaille sur de nouvelles méthodes capables de mieux associer le médicament et la nanoparticule. « Nous cherchons à identifier les liaisons chimiques entre le médicament et la nanoparticule pour mieux les rompre. Le but est de pouvoir libérer le médicament dans des conditions spécifiques, afin de cibler plus précisément l'action thérapeutique. » Certains travaux cherchent à développer des nanomédicaments contre d'autres maladies que les cancers : des infections ou des maladies cardiovasculaires par exemple.
Article réalisé avec la collaboration du Pr Patrick Couvreur, membre de l'Académie des sciences, spécialiste de la nanomédecine à l'université Paris-Sud.
Newsletter
S'abonner à la newsletter
Abonnez-vous pour recevoir les actualités et communications de la FRM, les projets et découvertes sur toutes les maladies…
Maltraitance infantile : quand le cerveau révèle les mécanismes de la résilience face à la dépression
17 février 2026


AVC : où en est la recherche ? CHECKPOINT revient en direct sur Twitch
09 février 2026


Rencontre à Genopolys avec les associations des notaires de Montpellier et de sa couronne
05 février 2026

