La Marche des Roses reverse 40 000€ pour faire avancer la recherche sur le cancer du sein !
12 décembre 2025


Depuis maintenant plusieurs années, les chercheurs disposent d'un nouvel outil très performant pour modifier précisément des portions d'ADN, le support de l'information génétique, chez les êtres vivants. Ce système, mis au point suite à des observations réalisées chez les bactéries, a pour nom CRISPR-Cas9. Retour sur une technique qui pourrait permettre de nombreuses avancées, aussi bien du point de vue de la connaissance que dans l'élaboration de nouvelles thérapies.
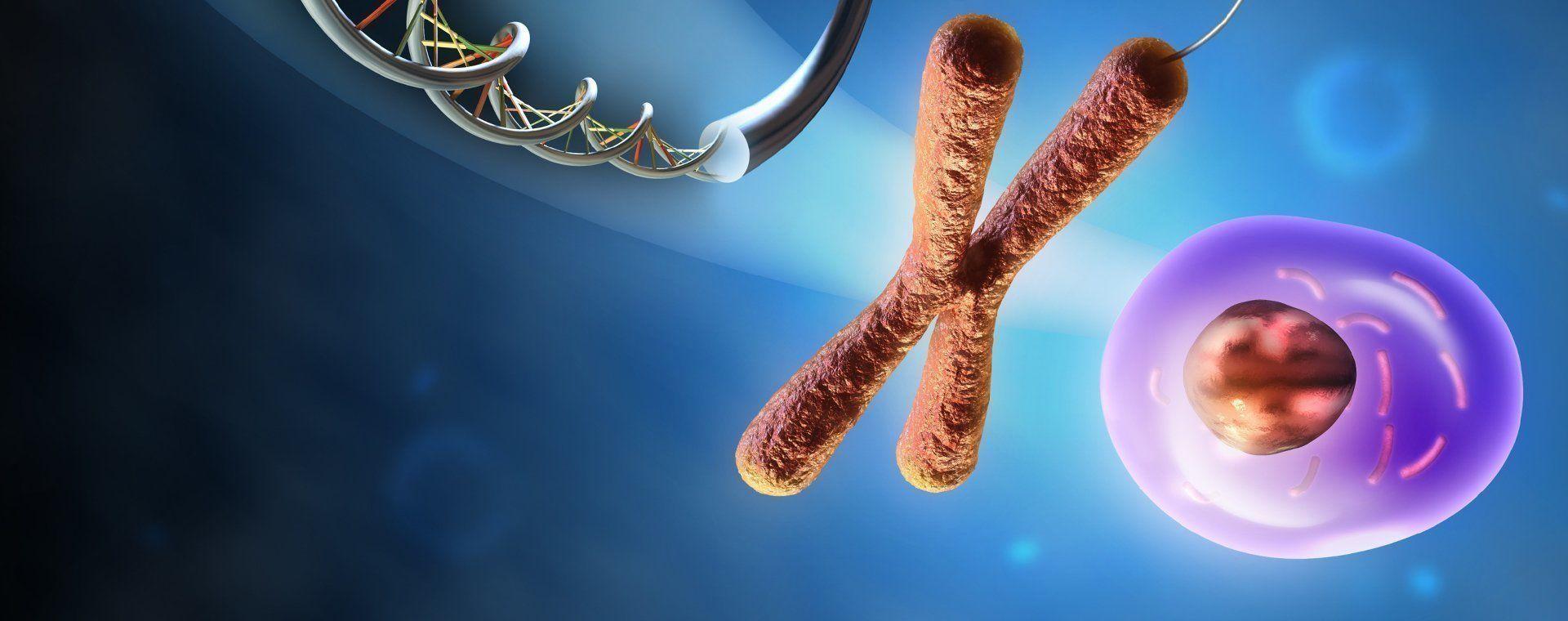
L'élaboration de cette technique découle d'un mécanisme découvert lors d'observations effectuées chez les bactéries. Pour le comprendre, nous pouvons faire une analogie avec nos systèmes de défenses immunitaires. Notre organisme, lorsqu'il rencontre un agent pathogène, met en place une réaction immunitaire en vue de le détruire. Dans un même temps, certaines cellules immunitaires acquièrent la capacité de reconnaître l'agent pathogène en vue de pouvoir réagir plus rapidement en cas d'infection ultérieure. Cette immunité, basée sur une reconnaissance spécifique d'un élément étranger par des cellules spécialisées, est appelée « immunité adaptative ».
Contrairement aux idées reçues, les bactéries sont également soumises à des attaques par des éléments étrangers. L'organisme en question est souvent un « phage », un virus qui infecte spécifiquement les bactéries. Les phages n'ont pas la capacité de se multiplier par eux même. Pour se faire, ils doivent injecter leur matériel génétique sous forme de molécule d'ADN au sein de la bactérie. C'est ensuite elle qui, grâce à sa machinerie interne, fabrique et assemble les différentes parties du phage. Au terme de ce cycle, les phages nouvellement formés sortent de la bactérie pour en réinfecter d'autres.
Certaines espèces de bactéries ont développé un système de défense face à cette infection phagique. Si la plupart des bactéries meurent à la suite du processus d'infection, une partie d'entre elles survivent et conservent en elles une portion de l'ADN du phage. Ce fragment s'insère dans des régions appelées CRISPR (pour « courtes répétitions en palindrome regroupées et régulièrement espacées ») situées dans l'ADN bactérien.
Il constitue une sorte de vaccin pour la bactérie. En cas de nouvelle infection par un phage du même type, ce fragment d'ADN inséré dans les séquences CRISPR est utilisé par la bactérie pour créer une molécule intermédiaire, un ARN, spécifique à l'ADN du phage et permettant sa reconnaissance. Cet ARN se lie avec une enzyme, Cas9, et l'ensemble se fixe sur l'ADN injecté par le phage dans la bactérie. L'enzyme Cas9 effectue alors une coupure dans le matériel génétique du phage, le rendant inopérant : l'infection est enrayée, le phage ne pouvant plus utiliser la machinerie bactérienne pour se multiplier.
Comme on l'aura compris, le système CRISPR-Cas9 constitue un véritable « ciseau moléculaire » : il permet de couper l'ADN à des endroits très précis au sein de gènes ciblés. Les chercheurs ont adapté ce mécanisme bactérien pour créer une technique applicable au cours de leurs travaux. Il s'agit ici de créer un ARN « guide » capable de se fixer à la portion d'ADN à couper, accompagné de la séquence CRSPR. Associé à l'enzyme Cas9, l'ensemble peut alors cibler la zone d'ADN d'intérêt.
En effet, si des outils de modification de l'ADN existaient déjà auparavant, le système CRISPR-Cas9 constitue une véritable avancée pour les chercheurs. Son principal avantage est sa simplicité. Autre point fort : son large spectre d'utilisations possible. CRISPR-Cas9 peut ainsi servir à inactiver un gène dans un organisme ou à en contrôler l'utilisation, à modifier certaines portions d'un gène Autant d'atouts en recherche fondamentale pour mieux appréhender le fonctionnement et le rôle de certains gènes, et ainsi ouvrir de nouvelles pistes.
CRISPR-Cas9 représente également un espoir formidable dans la mise au point de traitement de pathologies héréditaires liées à la mutation d'un gène unique comme la myopathie de Duchenne. Cette technique, appliquée dans le cadre de la thérapie génique, pourrait constituer un moyen de modifier et ainsi rétablir les pleines fonctionnalités d'un gène altéré et ainsi traiter la pathologie qui en résulte. Il reste néanmoins encore beaucoup de chemin à parcourir pour que cette technique soit fonctionnelle.
D'autres applications sont également en cours d'évaluation. Par exemple, des chercheurs chinois testent actuellement une thérapie basée sur CRISPR-Cas9 dans le traitement du cancer du poumon agressif. Certaines cellules immunitaires présentent un gène qui les rend moins efficaces pour lutter contre les cellules cancéreuses. Les chercheurs ont prélevé ces cellules chez les patients, et y ont inactivé ce gène avant de réinjecter les cellules dans la circulation. Les chercheurs pensent ainsi qu'elles seront plus efficaces pour détruire les tumeurs cancéreuses.
Pour résumer, la technique CRISPR-Cas9 a d'ores et déjà été utilisée de façon expérimentale par plusieurs centaines de laboratoires dans le monde pour modifier des cellules végétales et animales, mais aussi des souris, des porcs, des singes, et même des embryons humains, et ce non sans quelques dégâts collatéraux comme l'apparition de mutations génétiques non désirées Si bien que plusieurs chercheurs de renom ont appelé l'année dernière à un moratoire quant à l'utilisation de CRISPR/Cas9 à des fins de recherche sur des embryons humains. Un encadrement nécessaire pour prévenir les dérives potentielles dans son utilisation.
Newsletter
Restez informé(e) !
Abonnez-vous pour recevoir les actualités et communications de la FRM, les projets et découvertes sur toutes les maladies…