Troubles du rythme cardiaque : un peptide prometteur pour la prise en charge des dysfonctions du nœud sinusal


Plus de 2,7 millions de Français vivent avec un trouble du rythme cardiaque, dont deux millions avec une fibrillation atriale. Parfois asymptomatiques, ces anomalies sont sources de complications potentiellement graves, comme l’accident vasculaire cérébrale ou la mort subite. Mais les outils de dépistage et de diagnostic s’améliorent sans cesse. De nombreux traitements médicaux ou chirurgicaux permettent aussi de réduire drastiquement les risques associés.
Dans cette FAQ, la Fondation pour la recherche médicale répond à toutes vos questions sur les troubles du rythme cardiaque, leurs différentes formes, les symptômes, le diagnostic et les traitements.
Il existe différents troubles spécifiques du rythme cardiaque.
Le plus fréquent est la fibrillation atriale (ou auriculaire). Celle-ci se traduit par une contraction irrégulière des oreillettes du cœur, perturbant la bonne circulation du sang dans le cœur et l’organisme. Le sang a alors aussi tendance à stagner dans le cœur, ce qui augmente le risque de constitution d’un caillot sanguin. S’il est expulsé dans la circulation sanguine, ce caillot peut alors provoquer un accident vasculaire cérébral (AVC).
Plus rare, la fibrillation ventriculaire est, elle, la plus dangereuse. Le rythme de contraction des ventricules cardiaques s’emballe et devient si rapide que le sang ne peut plus être correctement éjecté hors des cavités cardiaques. La situation devient si critique qu’un arrêt cardiaque peut survenir, et être responsable d’une « mort subite ».
Heureusement, la plupart des troubles du rythme cardiaque ne sont pas aussi dramatiques. Ils peuvent être sources d’un ralentissement ou d’une accélération momentanée du cœur, voire d’un battement irrégulier. Le dépistage précoce reste néanmoins essentiel afin de limiter le risque de développer des troubles plus sévères.
Avec l’âge, certaines cellules musculaires cardiaques disparaissent. Elles sont peu à peu remplacées par des cellules fibreuses qui ne conduisent pas l’impulsion électrique, responsable de la contraction régulière du cœur. Lorsque le tissu fibreux devient trop important, il peut alors gêner la conduction électrique et perturber le rythme cardiaque. D’autres maladies cardiaques, comme un infarctus du myocarde récent, une valvulopathie ou une hypertension artérielle, peuvent également interférer sur la bonne conduction électrique. Des maladies ou certaines habitudes sont également des facteurs de risque de trouble du rythme cardiaque, comme l’apnée du sommeil, les troubles thyroïdiens ou la consommation d’excitants.
Plusieurs symptômes, tels que des palpitations, un essoufflement ou une fatigue, peuvent alerter sur un possible trouble du rythme cardiaque. Dans certains cas, aucun symptôme spécifique ne peut être détecté par le patient. Dans tous les cas, seul l’électrocardiogramme pourra confirmer (ou non) la présence d’un trouble du rythme cardiaque. Un test d’effort consistant en la réalisation d’un exercice physique intense sous la surveillance de son cardiologue permet de déceler les troubles du rythme cardiaque survenant à l’effort. Dans certains cas, la surveillance du rythme cardiaque sur une plus longue durée peut être proposée : le patient est alors équipé d’un holter ECG, un dispositif portatif enregistrant le rythme cardiaque pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Cet examen permettra de déceler des troubles du rythme dans la vie quotidienne. D’autres examens tels l’imagerie médicale, l’examen électrophysiologique ou un** bilan sanguin** peuvent être réalisés afin d’identifier plus finement l'origine du trouble du rythme et ses éventuelles complications.
Le traitement dépend du type de trouble du rythme cardiaque et de sa gravité. Dans les cas les plus bénins, le médecin pourra proposer de simples mesures hygiéno-diététiques (alimentation équilibrée et sans excitants, activité physique régulière). Pour les atteintes plus graves, différents traitements médicamenteux sont disponibles : les anti-arythmiques, les bêtabloquants, les inhibiteurs calciques ou encore les anticoagulants.
Pour les cas résistants aux traitements, l’ablation chirurgicale peut être proposée. Elle consiste en la suppression des cellules à l’origine de l’arythmie. Différentes techniques existent : la zone lésée peut être détruite par radiofréquence (c’est-à-dire brûlée) ou par cryoablation (gelée). Depuis quelques mois, la technique de l’électroporation (en perçant de manière microscopique les zones lésées afin de les isoler) est employée dans différents hôpitaux. La pose d’un pacemaker peut être nécessaire pour soutenir la contraction régulière du cœur.
En cas d’urgence, l’usage d’un défibrillateur externe peut être employé pour relancer la contraction régulière du cœur et l’implantation d’un défibrillateur automatique peut être requise.
Les troubles du rythme cardiaque peuvent être totalement asymptomatiques. Le patient ne ressent aucun trouble particulier et seule la réalisation d’un ECG permet de mettre à jour l’anomalie. Dans d’autres cas, le patient pourra ressentir des palpitations, un essoufflement, une grande fatigue, des vertiges, voire faire un malaise. Ces symptômes doivent orienter le médecin vers la réalisation d’examens complémentaires pour vérifier la régularité du rythme cardiaque.
Les troubles du rythme cardiaque présentent de nombreuses formes. Dans son fonctionnement normal, le cœur bat à un rythme de 50 à 100 pulsations par minute. Quand le rythme est trop lent (en dessous de 50 battements par minute), on parle de bradycardie. A l’inverse, lorsqu’il est trop rapide (plus de 100 battements par minute, au repos), il s’agit d’une tachycardie. Dans certains cas, le cœur bat de façon anarchique, sans fréquence régulière. On parle alors plus simplement d’une arythmie.
Dossier
Tout savoir sur les troubles du rythme cardiaque
Définition, chiffres clés, diagnostic, traitements… Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur les troubles du rythme cardiaque, ainsi que les pistes de recherche actuelles.
Newsletter
Restez informé(e) !
Abonnez-vous pour recevoir les actualités et communications de la FRM, les projets et découvertes sur toutes les maladies…
Troubles du rythme cardiaque : un peptide prometteur pour la prise en charge des dysfonctions du nœud sinusal


Arythmies : explorer les mécanismes en jeu dans la fibrillation ventriculaire


Troubles du rythme cardiaque : un risque de fibrillation auriculaire augmenté après la perte d’un conjoint
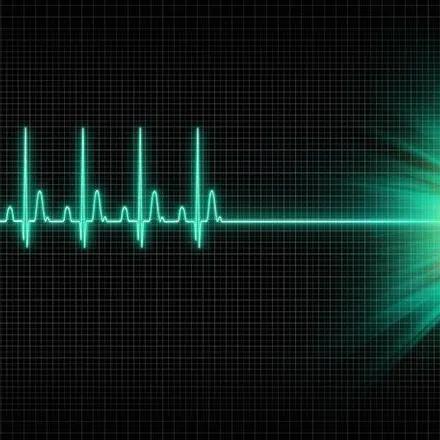
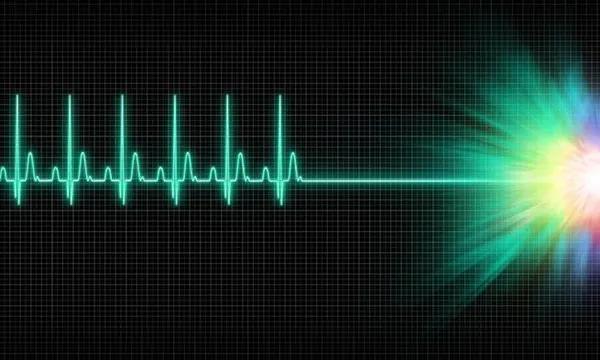
Maladies cardiovasculaires
