Virus émergents : identification de la structure d’une protéine virale impliquée dans l’infection par les virus alphavirus


Les virus émergents, par leur caractère soudain et leur facilité de propagation, constituent un véritable problème mondial de santé publique.
Depuis plusieurs décennies, ils sont responsables de nombreuses maladies parfois sévères voire létales.
La recherche se penche sur les mécanismes infectieux en vue de développer de nouveaux traitements antiviraux et des vaccins innovants.
projets financés sur les maladies infectieuses ces 5 dernières années
alloués à la recherche sur les maladies infectieuses en 2024
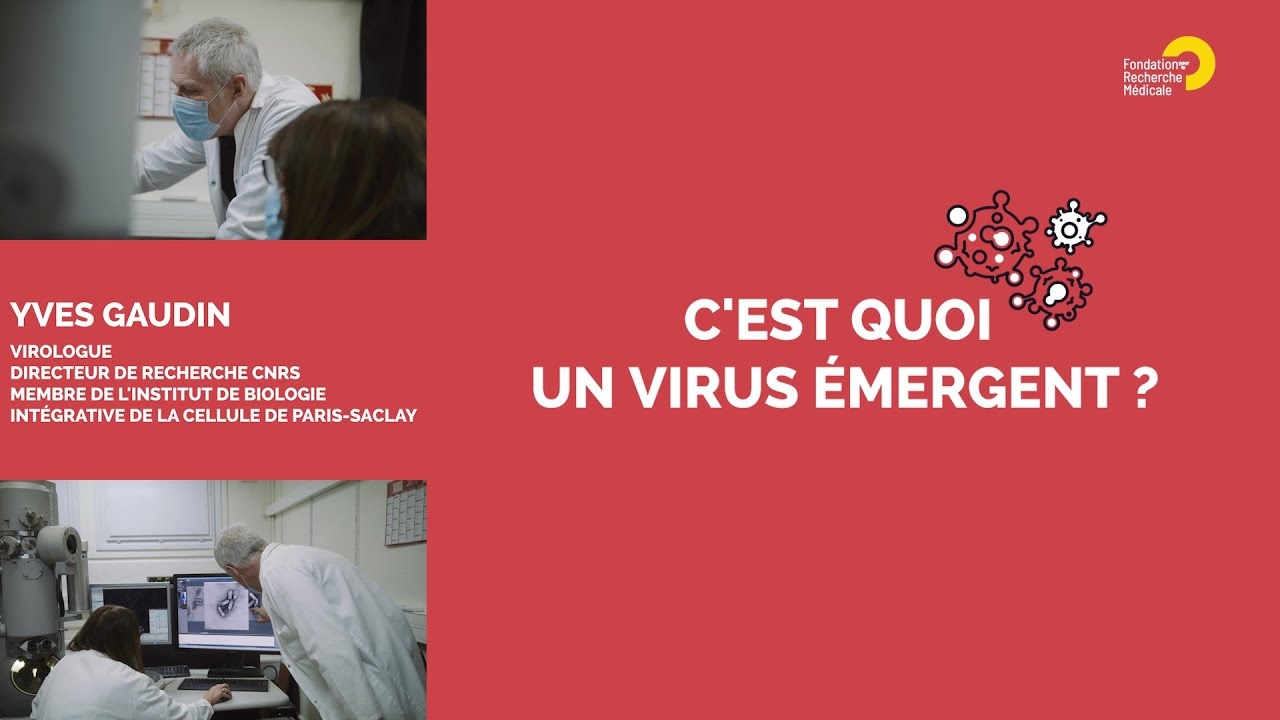
Les maladies infectieuses émergentes : quelles sont-elles ? Comment les prévenir ? Le décryptage de Yves Gaudin, virologue, directeur de recherche au CNRS.
Virus émergents : identification de la structure d’une protéine virale impliquée dans l’infection par les virus alphavirus


Virus émergents : comprendre comment les chauves-souris résistent aux infections virales pour développer de nouvelles approches


Virus émergents : découverte d’une porte d’entrée du virus de la fièvre hémorragique Crimée-Congo dans les cellules




Définition, chiffres clés, diagnostic, traitements… Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur les virus émergents, ainsi que les pistes de recherche actuelles.
Maladies infectieuses
