Une protéine transporteuse d’ions mise en cause dans l'épilepsie


L’épilepsie touche 50 millions de personnes dans le monde. Elle s’exprime au travers de crises, générées par une activité électrique anormale du cerveau. Si ces manifestations peuvent être impressionnantes, elles recouvrent une grande diversité de formes et d’intensités, ce qui rend le diagnostic de la maladie parfois complexe.
Grâce aux avancées médicales, de nombreux patients peuvent aujourd’hui bénéficier de traitements efficaces. Toutefois, près d’un tiers des personnes concernées restent en situation d’épilepsie pharmaco-résistante, soulignant l’importance cruciale de la recherche pour améliorer la qualité de vie des malades et développer de nouvelles options thérapeutiques.
L’épilepsie est une pathologie neurologique fréquente. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), elle touche 50 millions de personnes dans le monde et 2,4 millions d’individus sont diagnostiqués épileptiques chaque année. D’après l’Assurance maladie, plus de 685 000 français étaient suivis pour une épilepsie en 2020. Selon l’Inserm, 50 % des patients ont moins de 20 ans. Enfin, la moitié des enfants concernés guériraient à l’âge adulte d’après l’Assurance maladie.
L’épilepsie se manifeste cliniquement par des « crises », les crises d’épilepsie. Ces dernières se déclenchent à la suite d’une activité neuronale anormale dans le cerveau. Ainsi, les neurones « s’hyperactivent » et envoient des décharges électriques excessives dans les réseaux cérébraux auxquels ils sont connectés. Les zones cérébrales recevant les impulsions sont surstimulées, entraînant les symptômes de la maladie.
Les crises d’épilepsie partielles, ou crises focales, ne touchent qu’une zone cérébrale localisée. Les symptômes diffèrent selon le lieu où la décharge se produit. Il peut y avoir des troubles moteurs, sensoriels, du comportement ou du langage. Les crises focales sont souvent la conséquence d’une lésion cérébrale sous-jacente. Parfois, elles restent discrètes, avec seulement des sensations inhabituelles, des troubles du langage ou des gestes automatiques. On parle dans ce cas de crises simples. Les crises complexes s’accompagnent quant à elles d’une perte de conscience.
À l’inverse des crises focales, les crises d’épilepsie généralisées correspondent à des décharges électriques qui s’étendent à l’ensemble du cerveau. Elles peuvent dériver d’une crise partielle.
Parmi les crises généralisées, les crises tonico-cloniques, ou « grand mal », se manifestent par des convulsions, des raideurs, des chutes et une contraction de la mâchoire. Il y a une perte de conscience totale quasi-immédiate. Les crises d’absence, ou « petit mal », induisent pour leur part des ruptures dans la conscience allant de quelques secondes à quelques minutes et pouvant se répéter à plusieurs reprises dans la journée, sans convulsion. Ces formes atteignent plus volontiers les enfants.
On rencontre aussi d’autres types de crises : les crises myocloniques, marquées par des secousses musculaires brèves et soudaines, et les crises atoniques, entraînant une perte du tonus musculaire provoquant des chutes.
Les causes de l’épilepsie sont multiples et dépendent en partie de l’âge de survenue de la maladie. On distingue les formes symptomatiques, pour lesquelles une cause identifiée est retrouvée, et les formes idiopathiques, dont l’origine reste inconnue.
Chez l’adulte, l’épilepsie peut être la conséquence de lésions cérébrales acquises, comme un traumatisme crânien, un accident vasculaire cérébral (AVC), une tumeur cérébrale ou encore une infection, par exemple une méningite ou encéphalite.
Chez l’enfant, elle peut être liée à des anomalies du développement cérébral, des maladies génétiques, des erreurs du métabolisme ou des lésions périnatales.
Des facteurs génétiques jouent également un rôle important. Certaines épilepsies sont en effet associées à des mutations spécifiques pouvant apparaître de novo, c’est-à-dire qu’elles ne sont présentes que chez le patient et pas chez ses parents.
Enfin, des facteurs déclenchants peuvent favoriser les crises chez les personnes épileptiques, sans pour autant être la cause de la pathologie. Parmi ces facteurs, on retrouve le manque de sommeil, le stress, la consommation d’alcool ou de drogues, et la lumière clignotante, impliquée dans l’épilepsie photosensible.
Le diagnostic de l’épilepsie peut prendre du temps, car il dépend grandement des symptômes et de leur bonne interprétation. Ainsi, en premier lieu, le médecin peut avancer le diagnostic après un interrogatoire et selon la présentation clinique.
Ensuite, des examens peuvent être prescrits pour confirmer le diagnostic, comme l’électroencéphalogramme (EEG). Celui-ci permet d’observer l’activité électrique cérébrale par le biais d’électrodes posées à la surface du crâne. Cet examen est effectué dans des conditions particulières visant à déclencher l’activité neuronale anormale. Il peut être répété plusieurs fois, car la sensibilité augmente au fil des électroencéphalogrammes réalisés.
En complément, le médecin peut également avoir recours à l’imagerie par résonnance magnétique (IRM) ou au scanner afin de dépister les causes éventuelles de l’épilepsie et le retentissement des crises sur les structures du cerveau. L’IRM cérébrale est recommandée chez tous les patients pour identifier d’éventuelles anomalies structurelles, comme une tumeur ou une cicatrice cérébrale, qui pourraient expliquer l’épilepsie.
Dans certains cas complexes, d’autres explorations spécialisées peuvent être envisagées, comme un enregistrement vidéo-EEG prolongé, voire des examens génétiques.
La prise en charge de l’épilepsie repose en première intention sur des médicaments antiépileptiques, ou anti-crise. De nombreuses molécules sont disponibles et le choix dépend du type de crise, focale ou généralisée, de l’âge du patient, de son mode de vie et de la tolérance au traitement. Les plus utilisées sont la lamotrigine, le valproate, le lévétiracétam et la carbamazépine, qui permettent de stabiliser l’activité électrique du cerveau, de prévenir les crises ou d’en réduire l’intensité. L’Inserm estime que 60 à 70 % des patients répondent bien aux antiépileptiques. De plus, ces médicaments ne doivent pas nécessairement être pris à vie, car la maladie peut être guérie sur un temps court.
Cependant, certaines personnes ne répondent pas aux traitements. On parle alors d’épilepsie pharmaco-résistante. Dans ce cas, les crises persistent malgré l’utilisation appropriée de deux médicaments bien choisis et bien tolérés. Cela justifie une prise en charge dans un centre spécialisé afin de réévaluer le diagnostic, le traitement, et envisager des options alternatives.
La solution thérapeutique pour les cas les plus graves ou résistants est la chirurgie. La chirurgie curative consiste à retirer la zone du cerveau à l’origine de l’épilepsie, ou zone épileptogène, sous réserve qu’elle soit accessible et que son ablation ne provoque pas de lésions neurologiques majeures. Cette chirurgie peut permettre une guérison. Elle est précédée d’un bilan pré-chirurgical approfondi, incluant des enregistrements prolongés par EEG, une imagerie de haute précision et parfois, une stimulation cérébrale.
Dans un but palliatif, pour soulager le patient des symptômes de l’épilepsie, il peut être proposé l’implantation d’un stimulateur miniature visant à exciter le nerf vague. Par ce biais, des signaux sont transmis jusqu’au cerveau afin de réduire la fréquence des crises.
Les traitements de l’épilepsie génèrent de nombreux effets secondaires, comme des somnolences et des nausées, qui peuvent pénaliser le patient dans sa vie courante. De plus, les malades ne répondant pas aux traitements médicamenteux ne peuvent pas toujours avoir recours à la chirurgie. Enfin, lorsqu’elle est possible, cette approche ne donne pas 100 % de résultats. Il est donc important que les recherches sur l’épilepsie se poursuivent, afin de mettre au point de nouvelles thérapies. Des travaux donnent déjà des résultats prometteurs. En parallèle, plusieurs essais de thérapie génique sont menés dans des modèles d’épilepsies pharmaco-résistantes. Ils consistent à apporter des gènes spécifiques aux neurones pour contrôler les crises.
Encore du côté de la génétique, les chercheurs redoublent d’efforts pour déterminer les gènes en cause dans les épilepsies héréditaires. L’identification de mutations spécifiques dans les tissus cérébraux pourrait permettre un diagnostic plus précoce et plus précis, mais aussi ouvrir la voie à des traitements ciblés en fonction du profil génétique du patient. Les scientifiques s’intéressent par ailleurs au rôle de certains neurones et de leur physiologie dans l’apparition des crises.
L’imagerie cérébrale connaît également des avancées majeures. Les techniques d’IRM à haute résolution et de tomographie par émission de positons (TEP) permettent de repérer plus finement les zones épileptogènes, facilitant ainsi la sélection des candidats à la chirurgie. Parallèlement, des modèles virtuels du cerveau, dits in silico, sont développés pour simuler l’activité neuronale et prédire le déclenchement des crises dans une optique de médecine personnalisée.
On peut aussi citer les récents progrès réalisés par des chercheurs avec l’aide de la FRM : ils ont mis au point des électrodes intracérébrales qui permettent d’enregistrer avec précision l’activité neuronale et ainsi, de détecter précocement une crise d’épilepsie. Ils poursuivent actuellement leurs investigations pour perfectionner leur dispositif.
Outre la chirurgie classique, d’autres techniques sont à l’étude pour traiter l’épilepsie : la thermocoagulation par radiofréquence, la chirurgie au laser guidée par IRM, ou encore la stimulation cérébrale profonde, qui consiste à envoyer des impulsions électriques dans des zones précises du cerveau pour limiter l’apparition des crises. Ces innovations offrent des perspectives aux patients inopérables ou réfractaires aux autres traitements.
Newsletter
Restez informé(e) !
Abonnez-vous pour recevoir les actualités et communications de la FRM, les projets et découvertes sur toutes les maladies…
Avec la FRM, votre don est un espoir de guérison
Soutenez les projets de recherche les plus prometteurs contre les maladies neurologiques
Une protéine transporteuse d’ions mise en cause dans l'épilepsie


Epilepsie : un cerveau virtuel pour améliorer la prise en charge
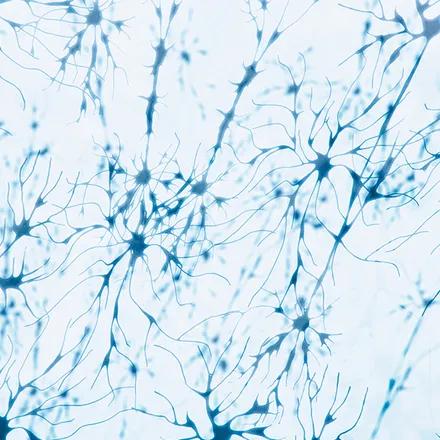
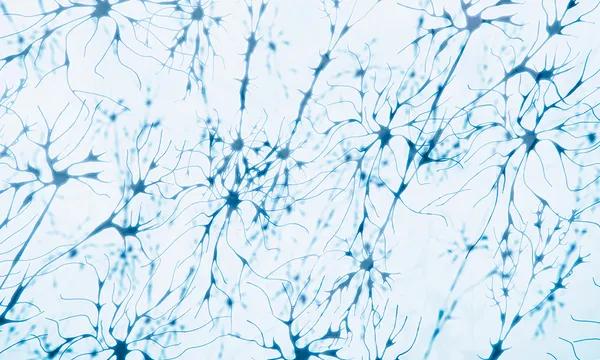
Epilepsie : explorer l’impact de certains neurones dans la maladie
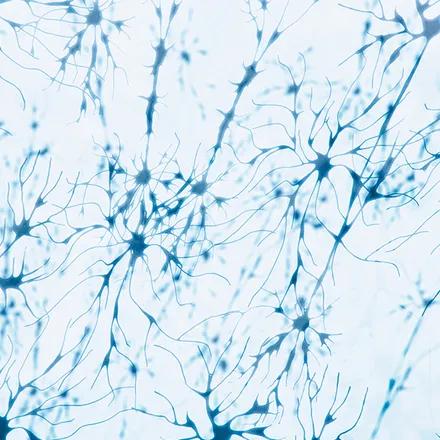
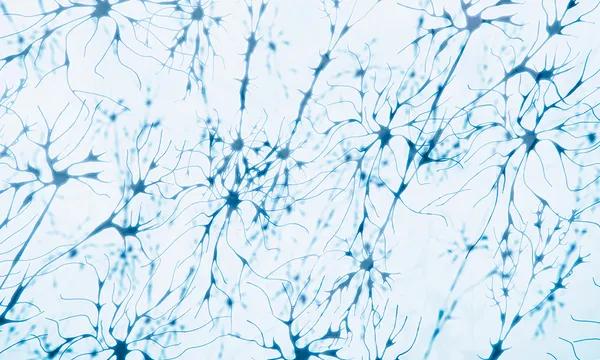
Maladies neurologiques et psychiatriques
