Méningite : Mieux connaître le streptocoque du groupe B pour le contrer chez le bébé


La méningite est une infection des méninges, les membranes qui entourent le cerveau et la moelle épinière. Elle touche chaque année des milliers de personnes en France. Majoritairement provoquée par des bactéries ou virus, elle peut être dans certains cas prévenue grâce à la vaccination. Le diagnostic rapide est essentiel, car un traitement précoce conditionne le pronostic. Les recherches actuelles tentent de mieux comprendre les mécanismes de l’infection et explorent de nouvelles stratégies thérapeutiques.
Les infections invasives à méningocoque constituent des méningites bactériennes graves, en hausse depuis plusieurs années. En 2023, 560 cas ont été recensés, représentant une augmentation de 72 % par rapport à l’année précédente selon Santé publique France. En 2024, une nouvelle hausse a été observée avec 615 cas déclarés, le chiffre le plus élevé depuis 2010 d’après Vaccination Info Service.
Toutes formes confondues, les méningites ont entraîné près de 240 000 décès dans le monde en 2019. Les régions les plus touchées se situent dans la « ceinture de la méningite », en Afrique subsaharienne, où les conditions climatiques et socio-économiques favorisent la propagation de la maladie. D’après l’organisation mondiale de la santé (OMS), 1 personne sur 10 infectées par une méningite bactérienne en meurt, et 1 sur 5 est l’objet de complications sévères.
La méningite se caractérise par une inflammation au niveau des méninges, les membranes qui entourent les tissus du système nerveux central, comprenant le cerveau et la moelle épinière. Cette inflammation fait le plus souvent suite à une infection dans laquelle plusieurs vecteurs peuvent être impliqués : virus, bactéries, parasites ou champignons. Les méningites les plus fréquentes et bénignes sont celles induites par des virus, et les plus graves, par des bactéries. L’inflammation des méninges peut aussi être la conséquence de pathologies générales, comme le cancer.
Les méningites virales sont en général liées aux entérovirus, surtout chez les enfants, mais elles peuvent également être déclenchées par des pathologies comme l’herpès, la varicelle, la rougeole et de nombreuses autres maladies virales.
Les méningites bactériennes sont les plus graves. Une bactérie est plus particulièrement incriminée : Neisseria meningitidis, appelée méningocoque, dont 6 types sont connus pour engendrer des épidémies. Les cas d’infections invasives à méningocoque ont été en recrudescence sur le début de l’année 2025, avec 95 cas notifiés dans l’hexagone selon Santé publique France.
D’autres bactéries provoquent des méningites, comme Streptococcus pneumoniae, appelée pneumocoque, et Haemophilus influenzae de type b (Hib), notamment chez les jeunes enfants non vaccinés. Chez les nourrissons de moins de trois mois, les agents les plus fréquents sont les streptocoques du groupe B et certaines entérobactéries.
Dans le cas des méningites nosocomiales, contractées en milieu hospitalier, des bactéries opportunistes comme Staphylococcus aureus ou Pseudomonas aeruginosa peuvent être impliquées, notamment après une chirurgie ou un traumatisme crânien.
Certaines formes rares de méningites sont d’origine tuberculeuse. Elles peuvent survenir lors de la dissémination de la bactérie Mycobacterium tuberculosis, aussi connue sous le nom de bacille de Koch, dans le système nerveux central.
Les méningites fongiques, dues à des champignons, et les méningites parasitaires, dues à des parasites, apparaissent habituellement chez des patients au système immunitaire déficient, par exemple chez les malades du sida, dont les cellules de défense de l’organisme ne remplissent plus leur rôle.
Bien que rares, des méningites non infectieuses peuvent également se développer dans le contexte de cancers métastasés, ou de maladies auto-immunes comme le lupus.
Le syndrome méningé correspond aux conséquences directes de l’infection. Les symptômes sont une raideur de la nuque, des maux de tête violents, une hypersensibilité à la lumière ou photophobie, et des vomissements. Ce syndrome peut s’accompagner de troubles de la conscience, de somnolences et de déficits moteurs suivant la gravité de la pathologie.
Le syndrome infectieux se manifeste principalement avec de la fièvre. Lorsque le méningocoque est impliqué, un purpura peut apparaître, c’est-à-dire des micro-saignements sous la peau et dans les muqueuses. Son extension est un élément de prise en charge en urgence de la pathologie.
Chez les nourrissons et jeunes enfants, les signes peuvent être atypiques ou moins marqués. On observe parfois une irritabilité, des pleurs inconsolables, des troubles de l’alimentation, des vomissements ou une hypotonie, c’est-à-dire un bébé « mou », et parfois une tension de la fontanelle. Chez les personnes âgées ou immunodéprimées, la méningite peut également être moins évidente à déceler. Elle peut s’exprimer avec une altération de l’état général, une confusion, ou une simple baisse de vigilance.
Un retard dans la reconnaissance des signes cliniques de la méningite augmente le risque de complications neurologiques graves, telles que des convulsions, une surdité, ou une hydrocéphalie. En cas de purpura fulminans, maladie infectieuse grave associée à un risque élevé de choc septique, la prise en charge doit être immédiate : c’est une urgence vitale.
Devant des symptômes évocateurs de méningite, le praticien a principalement recours à un examen afin de mettre en évidence la pathologie : la ponction lombaire. L’idée est ici de prélever du liquide céphalorachidien (LCR), le liquide biologique dans lequel baignent le cerveau et la moelle épinière, en vue de détecter les éventuels pathogènes qui s’y trouvent. Deux cas de figure peuvent alors se présenter. Si le LCR est clair, le germe en cause dans la méningite est probablement un virus. Si le LCR est trouble, ou purulent, il s’agit plutôt d’une méningite bactérienne.
Le liquide céphalorachidien est ensuite analysé pour déterminer avec précision l’espèce incriminée et mettre en place un traitement ciblé sur le pathogène. Cette analyse inclut une numération cellulaire, un dosage du taux de protéines et de sucre, ainsi qu’une recherche directe des agents infectieux par bactérioscopie, culture cellulaire ou PCR. Dans certains cas, des tests antigéniques ou de biologie moléculaire, sont réalisés afin d’identifier rapidement le germe en cause et de ne pas retarder la mise en route d’un traitement.
En complément de la ponction lombaire, d’autres examens peuvent être effectués. Une prise de sang vise dans un premier temps à évaluer l’état général du patient. Elle peut être associée à une imagerie par résonance magnétique (IRM) ou à un électroencéphalogramme, permettant d’observer des atteintes éventuelles ou des dysfonctionnements cérébraux.
Les thérapies utilisées pour prendre en charge les méningites sont directement liées au germe impliqué dans la maladie. Pour les formes virales de la pathologie, aucun traitement n’est mis en place, ces méningites étant le plus souvent bénignes.
Le traitement des méningites bactériennes fait en revanche appel à une antibiothérapie, tout d’abord à large spectre, notamment en cas de purpura étendu, puis ciblée sur le germe isolé une fois la ponction lombaire réalisée. D’autres médicaments peuvent être prescrits en complément, tels que des antalgiques pour lutter contre la douleur. Dans certaines formes bactériennes graves, des corticoïdes, comme la dexaméthasone, peuvent être associés à l’antibiothérapie afin de réduire le risque de complications neurologiques, en particulier la surdité.
Les formes liées à un champignon ou parasite sont respectivement traitées par des thérapies antifongiques ou antiparasitaires spécifiques.
La prise en charge de la méningite est systématiquement hospitalière. Elle a souvent lieu en unité de soins intensifs, en raison du risque vital et du besoin de surveillance rapprochée. Un isolement temporaire du patient peut être mis en place en cas de méningite à méningocoque, car cette forme est facilement transmissible. Une surveillance neurologique est également instaurée pour évaluer l’apparition d’éventuelles séquelles, qui justifieraient une prise en charge spécialisée impliquant de la rééducation ou un suivi ORL.
La prévention de la méningite, et de ses formes les plus graves, repose essentiellement sur la vaccination, l’hygiène et la gestion des cas contacts.
Plusieurs vaccins efficaces sont disponibles contre les principales bactéries responsables des formes graves de méningites : le pneumocoque Streptococcus pneumoniae, l’Haemophilus influenzae de type b (Hib) et le méningocoque Neisseria meningitidis. Ils font partie du calendrier vaccinal recommandé dès la petite enfance.
Concernant les méningocoques, plusieurs vaccins existent, ciblant les sérogroupes A, B, C, W et Y. En France, la vaccination contre le méningocoque C est obligatoire pour les nourrissons depuis 2018. Pour les personnes à risque accru, comme les immunodéprimés, les voyageurs en zones endémiques et les personnels de santé, des rappels ou des vaccinations élargies sont conseillés.
En cas de méningite bactérienne à méningocoque dans l’entourage, un traitement antibiotique préventif, ou prophylaxie, est proposé aux personnes ayant été en contact étroit avec le malade. Cette antibioprophylaxie doit être reçue dans les plus brefs délais, idéalement dans les 24 à 48 heures suivant le diagnostic, afin de prévenir l’apparition de cas secondaires. La rifampicine est fréquemment utilisée en première intention, mais en cas de contre-indication ou de résistance documentée, la ceftriaxone ou la ciprofloxacine peuvent être privilégiées.
En complément de l’antibioprophylaxie, la vaccination peut être envisagée pour les contacts proches non immunisés, en fonction du méningocoque impliqué. Ainsi, si la méningite du malade est due à une souche des sérogroupes A, C, W ou Y, un vaccin tétravalent conjugué est recommandé pour les proches, dans les 10 jours suivant le dernier contact avec le patient. En revanche, pour les infections à méningocoque B, la vaccination des cas contacts n’est généralement pas préconisée en dehors de situations épidémiques spécifiques.
Pour ce qui est des méningites non bactériennes, les premiers réflexes de prévention sont de traiter les pathologies sous-jacentes, comme le VIH, et d’améliorer les conditions sanitaires dans les pays à risque. Enfin, pour prévenir toute forme de méningite, il est indispensable de suivre des règles d’hygiène basiques, comme le lavage régulier des mains ou la minimisation du partage d’objets personnels tels que les verres et brosses à dents.
Une des principales avancées réalisées par les chercheurs sur la méningite est la mise au point de nombreux vaccins destinés à prévenir les infections par les méningocoques les plus virulents. Leur usage a permis de contenir les épidémies dans les pays les plus à risque. Les recherches actuelles visent à élargir la couverture vaccinale, à améliorer l’efficacité des vaccins existants et à anticiper l’émergence de nouveaux variants ou sérogroupes.
En lien avec la couverture vaccinale, les scientifiques travaillent sur la surveillance des souches circulantes, leur résistance aux traitements, et la modélisation de l’impact des différentes stratégies vaccinales. Cette surveillance permet d’anticiper les épidémies et d’ajuster les politiques de santé publique. L’OMS a lancé la feuille de route « Vaincre la méningite à l’horizon 2030 », avec pour objectifs d’éliminer les épidémies de méningite bactérienne, de réduire de 50 % les cas évitables par la vaccination et de 70 % les décès, tout en améliorant la prise en charge des séquelles.
Aujourd’hui, les recherches se concentrent encore sur les moyens de prendre en charge les méningites bactériennes, notamment celles liées aux méningocoques. Ces bactéries sont naturellement présentes dans la muqueuse nasale. Elles arrivent parfois à passer la barrière physiologique séparant le rhinopharynx du système nerveux central. Le franchissement de cette barrière est une étape clé de la colonisation cérébrale par ces bactéries.
Les chercheurs tentent de mieux comprendre comment elles franchissent cette barrière, en étudiant par exemple le comportement des micro-organismes au niveau des vaisseaux sanguins. Élucider ces mécanismes permettrait d’isoler de nouvelles cibles thérapeutiques exploitables dans la méningite. Ce préalable est indispensable à la mise au point d’antibiotiques plus efficaces.
Les chercheurs s’intéressent aussi à la réaction inflammatoire mise en place par l’organisme. Ils analysent pourquoi, dans certains cas, la réponse immunitaire devient excessive et incontrôlée, aggravant les lésions neurologiques. Ce travail permettra de développer des traitements pour moduler l’inflammation et limiter les séquelles de la méningite.
Un dernier enjeu important de la recherche consiste à réduire le handicap et à améliorer la qualité de vie des patients guéris de l’infection, en développant des stratégies de prise en charge précoce des complications et de réhabilitation neurologique.
Newsletter
Restez informé(e) !
Abonnez-vous pour recevoir les actualités et communications de la FRM, les projets et découvertes sur toutes les maladies…
Avec la FRM, votre don est un espoir de guérison
Soutenez les projets de recherche les plus prometteurs.
Méningite : Mieux connaître le streptocoque du groupe B pour le contrer chez le bébé


Méningite : une meilleure compréhension des mécanismes d’infection bactérienne
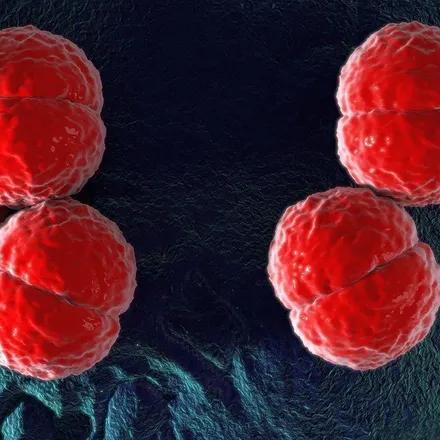
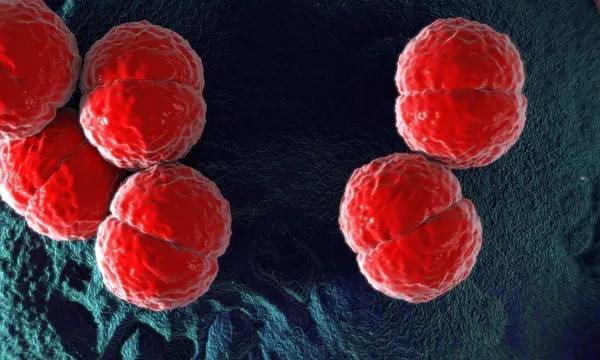
Méningite : premiers résultats significatifs du vaccin antipneumococcique en France


Maladies infectieuses
