Hépatite C : quels sont les facteurs génétiques prédisposant aux complications hépatiques liées à l’hépatite C


Depuis une dizaine d’années, de nouveaux traitements à l’efficacité exceptionnelle ont révolutionné la prise en charge de l’hépatite C. Cependant, le diagnostic est souvent retardé, car la maladie peut rester silencieuse pendant de nombreuses années. Le dépistage des personnes à risque est donc indispensable pour limiter des lésions hépatiques et l’évolution de la maladie vers des complications irréversibles.
Dans cette FAQ, le FRM répond à toutes vos questions sur l’hépatite C, les voies de contamination et les risques associés à cette maladie.
L’hépatite C peut évoluer pendant de très nombreuses années, à l’insu du malade. Les premiers symptômes peuvent apparaître 10, voire 20 ans, après l’infection. Mais avec l’évolution de la maladie, même si les symptômes sont légers, voire inexistants, l’atteinte du foie progresse. La destruction progressive des cellules hépatiques et l’inflammation anormale d’autres organes peuvent in fine faire apparaître des symptômes, signes que les lésions sont devenues graves.
Pour éviter que le foie ne soit trop endommagé, il est important de détecter la maladie au plus tôt. D’autant plus que les traitements sont efficaces et que le foie est capable de se régénérer. En revanche, certaines complications, telles la cirrhose et le cancer du foie, peuvent laisser des lésions irréversibles et engagent le pronostic vital du patient.
L’infection par le virus de l’hépatite C se traduit par une atteinte progressive du foie, avec destruction progressive des hépatocytes. Ceux-ci sont remplacés par une fibrose cicatricielle qui altère le fonctionnement normal du foie. En l’absence de traitement, la fibrose progresse et d’autres maladies, telles la cirrhose ou le cancer du foie, peuvent apparaître. Ces complications sont très graves, et le pronostic vital du patient est engagé.
L’hépatite C est une maladie infectieuse, c’est-à-dire qu’elle est portée par un virus. Celui-ci se contracte par une exposition à du sang contaminé (usage de seringues infectées lors de la consommation de drogues, transfusions de sang contaminé par exemple). S’installant dans le foie, le virus de l’hépatite C détruit les cellules hépatiques, altérant progressivement le fonctionnement normal de cet organe. La maladie peut progresser pendant de longues années, avant que des complications très graves (cirrhose, cancer) ne surviennent. La prolifération d’anticorps dans d’autres tissus peut également provoquer une inflammation anormale d’autres tissus et être responsable d’autres pathologies (diabète, cryoglobulinémie mixte par exemple).
Le virus de l’hépatite C est principalement transmis par le sang. La voie de contamination la plus fréquente est l’utilisation d’une seringue non stérile et infectée, par les usagers de drogues. Le virus de l’hépatite C peut également être transmis à l’occasion d’une transfusion de sang, si celui-ci n’a pas fait l’objet d’un dépistage. Dans les pays développés, cette voie de contamination est désormais rare, en raison de la mise en place de contrôles stricts. Le virus peut aussi être transmis par des rapports sexuels non protégés ou de la mère à l’enfant mais ces voies de contamination restent marginales.
Depuis une dizaine d’années, les antiviraux d’action directe pangénotypiques ont révolutionné la prise en charge de l’hépatite C. Ces traitements sont très efficaces, et 98 % des patients guérissent. En France, le traitement est pris en charge à 100 % par l’Assurance maladie, sur prescription médicale.
Les espoirs portés par ces traitements sont tels que l’OMS s’est donné pour objectif d’éliminer l’hépatite C, à l’horizon 2030. C’est-à-dire de réduire les nouvelles contaminations de 90 % et la mortalité de 65 %. Cependant, le prix du traitement et le manque de dépistage reste un frein à la prise en charge globale à l’échelle mondiale.
L’hépatite C peut être asymptomatique pendant de longues années, si bien que le diagnostic peut être retardé. En phase aiguë (deux semaines à six mois après l’infection), les symptômes sont discrets et peu spécifiques : fièvre, fatigue, ictère (jaunisse), urines foncées, selles blanchâtres, nausées et vomissements, douleurs abdominales, douleurs articulaires. Six mois après l’infection, la maladie passe en phase chronique, avec peu d’évolution des symptômes. L’apparition de manifestations extra-hépatiques ou de complications majeures, telles la cirrhose ou le cancer du foie, sont associées à des symptômes spécifiques.
Le virus de l’hépatite C peut se transmettre par les rapports sexuels, mais cette voie de contamination reste marginale, par rapport à l’usage de seringues contaminés ou les transfusions de sang n’ayant pas fait l’objet d’un dépistage. Pour que la transmission ait lieu, il faut qu’un contact avec du sang infecté ait lieu. Les rapports sexuels avec présence de sang sont plus à risque (blessures, lésions causées par d’autres pathologies tel le VIH, sexe anal non protégé). Ainsi, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, en particulier avec de multiples partenaires, sont davanatge touchés. Les travailleurs du sexe sont également une population à risque. Par ailleurs, les pratiques sexuelles dites brutales (c’est-à-dire pouvant provoquer des lésions) sont aussi associées à un risque accru de contraction de l’hépatite C.
Les hépatites B et C sont toutes deux des hépatites virales, c’est-à-dire des maladies infectieuses touchant le foie et transmises par un virus. Cependant, le virus à l’origine de la maladie n’est pas le même. Leurs modes de transmissions, dépistages, diagnostics, complications associées et traitement sont donc différents. L’hépatite B est plus répandue et dispose d’un vaccin. L’hépatite C ne dispose pas de vaccin mais d’un traitement efficace. A la différence du virus de l’hépatite C qui ne se transmet que par le sang, l’hépatite B se transmet par différents fluides corporels, tels le sang, le sperme, ou les sécrétions vaginales. Les rapports sexuels non protégés constituent donc une source majeure de contamination, alors que cette voie reste marginale pour l’hépatite C. En outre, l’hépatite B ne se guérit pas totalement, à la différence de l’hépatite C. La vaccination contre l’hépatite B est donc primordiale.
Dossier
Tout savoir sur l'hépatite C
Chiffres clés, définition, diagnostic, traitements… Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur les infections nosocomiales, ainsi que les pistes de recherche actuelles.
Newsletter
Restez informé(e) !
Abonnez-vous pour recevoir les actualités et communications de la FRM, les projets et découvertes sur toutes les maladies…
Hépatite C : quels sont les facteurs génétiques prédisposant aux complications hépatiques liées à l’hépatite C


Hépatite C : mieux prendre en charge les vascularites cryoglobulinémiques
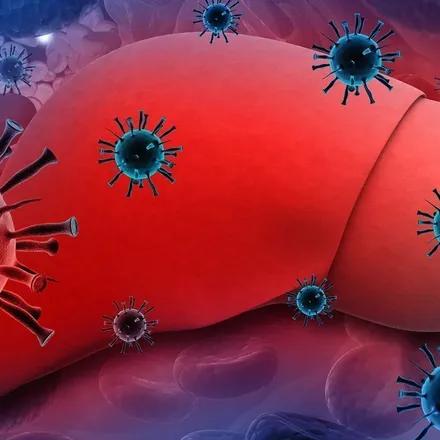
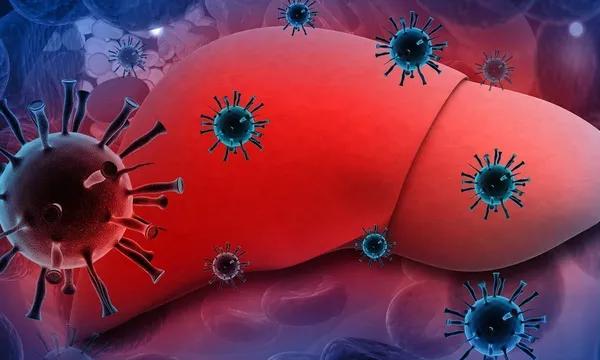
Hépatite C : découverte d’un nouveau mécanisme d’action d’une molécule antivirale
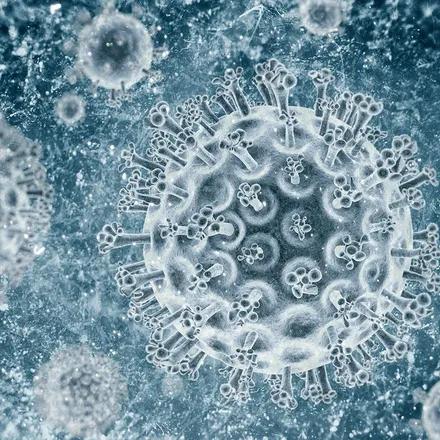
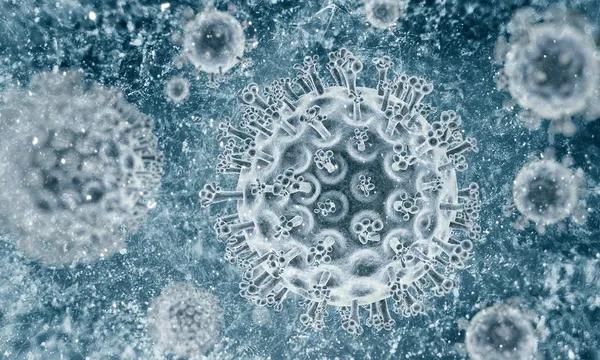
Maladies infectieuses
