Deux protéines clés dans le syndrome des antiphospholipides
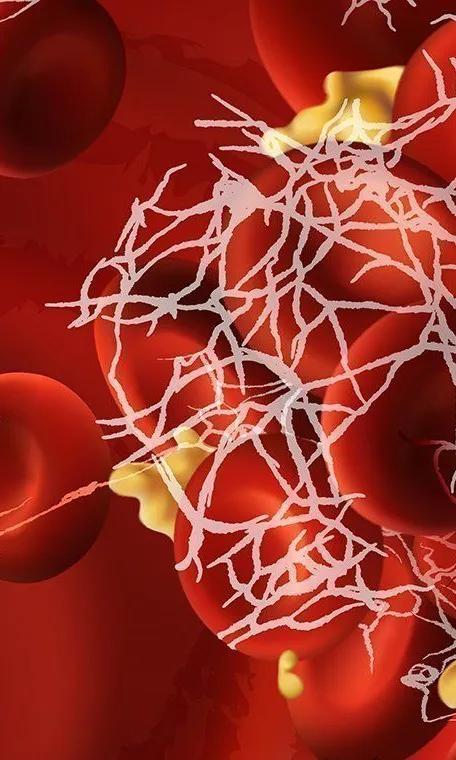
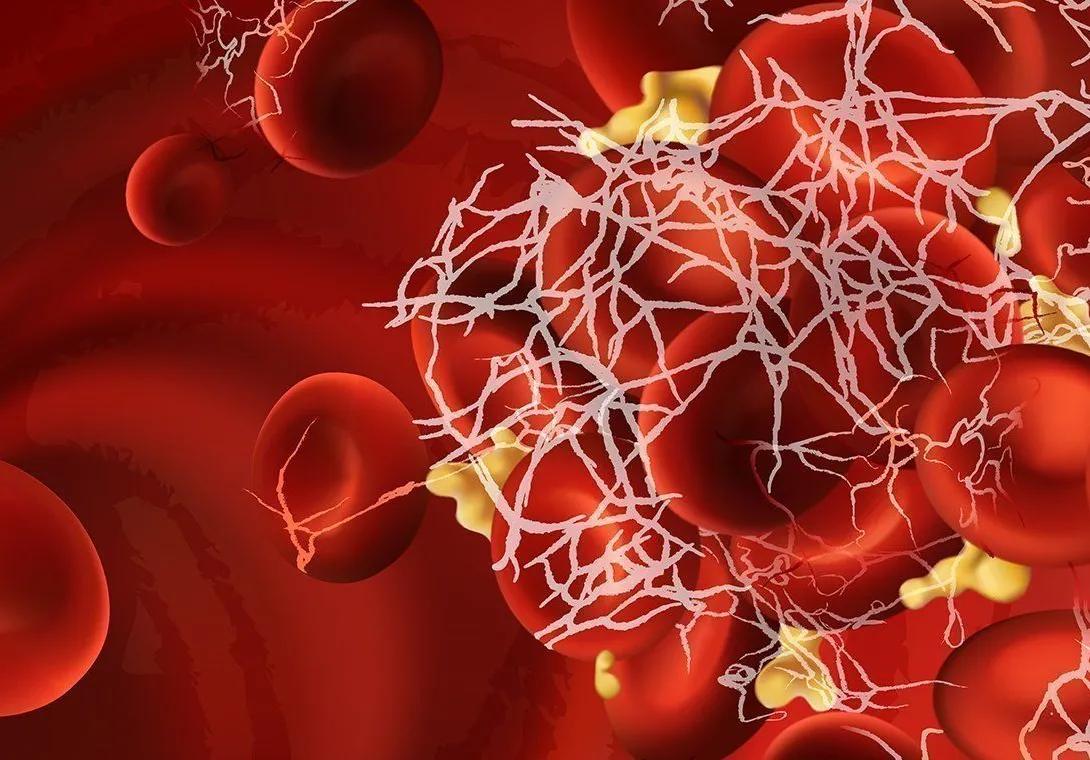
Les maladies veineuses thrombo-emboliques, telles la thrombose veineuse (encore appelée phlébite) et l’embolie pulmonaire, touchent près de 900 000 Français. Ces pathologies apparaissent lorsqu’un caillot sanguin se forme au niveau d’une veine, généralement dans la jambe. Le principal danger est que celui-ci se détache, remonte jusqu’au cœur et bouche l’une des artères pulmonaires, c’est l’embolie pulmonaire. Une hospitalisation prolongée ou le cancer sont des facteurs de risque bien identifiés. Pour prévenir la formation de caillots et la récidive, les patients à risque reçoivent des traitements anticoagulants. Mais ces médicaments présentent des effets secondaires. La recherche tente d’identifier de nouvelles molécules plus sûres et de mieux comprendre les mécanismes pour prévenir les accidents.
Dans cette page, nous présentons les maladies qui touchent le système veineux. Pour en savoir plus sur les maladies des artères (dans lesquelles circule le sang riche en oxygène en provenance du cœur et en direction des différents organes), vous pouvez consulter la fiche sur l’athérosclérose.
Selon l'Inserm, près de 18 millions de Français souffrent d’insuffisance veineuse. Les femmes sont davantage touchées que les hommes avant 45 ans mais cette tendance s’inverse après 85 ans.
Selon Santé publique France, en 2022, près de 897 000 Français avaient déjà souffert d’une maladie veineuse thrombo-embolique ayant nécessité une hospitalisation ou une déclaration en affection de longue durée (ALD). Plus d’un tiers d’entre eux (37,4 %) étaient âgés de moins de 65 ans. Cette année-là, 62 055 personnes ont été hospitalisées pour cette raison (dont 78,1 % pour une embolie pulmonaire).
On estime que, chaque année, en France, surviennent près de 250 000 phlébites superficielles (touchant des veines sous-cutanées), 50 et 100 000 phlébites profondes, et plus de 40 000 embolies pulmonaires.
L’embolie pulmonaire représente une cause importante de mortalité cardiovasculaire : 6 % des patients en phase aiguë décèdent et 26 % dans l’année qui suit.
Les maladies des vaisseaux comprennent les pathologies touchant les artères (anévrisme, athérosclérose et leurs complications, la rupture d’anévrisme, l’accident vasculaire cérébrale, l’infarctus du myocarde) et les veines (insuffisance veineuse, varice, phlébite et sa complication l’embolie pulmonaire). Certaines maladies, telles les vascularites (caractérisées par une inflammation des vaisseaux), touchent les deux types de vaisseaux.
Les maladies des veines regroupent l’insuffisance veineuse et ses conséquences (varices, etc.) et les maladies veineuses thrombo-emboliques (MVTE), telles la phlébite et sa complication, l’embolie pulmonaire.
L’insuffisance veineuse est liée à un manque d’élasticité et de tonicité des veines ou à un dysfonctionnement de la paroi des veines. Elle se traduit par un mauvais retour veineux : la circulation sanguine en provenance des membres inférieurs est perturbée, le sang remonte difficilement vers le cœur. Résultat : celui-ci a tendance à stagner dans les membres inférieurs, pouvant provoquer des complications (telles les varices, voire des thromboses).
Les thromboses veineuses, encore appelées phlébites, se caractérisent par la formation et le développement d’un caillot sanguin (thrombus) dans une veine. Elles se développent généralement dans les membres inférieurs, seuls 5 à 10 % sont localisés sur un membre supérieur. Lorsque le caillot sanguin se développe dans une veine en surface (sous-cutanée), on parle de phlébite superficielle ou paraphlébite. Elle est généralement peu dangereuse. En revanche, lorsqu’elle survient en profondeur, les risques sont plus importants. Par ailleurs, la thrombose veineuse peut être distale (dans le mollet) ou proximale (dans la cuisse). Lorsque la phlébite est profonde et proximale, le risque principal est l'embolie pulmonaire : la pression sanguine augmentant, le caillot initialement présent dans une veine profonde de la jambe peut se détacher et migrer jusqu'au cœur. Là, il est propulsé dans les artères pulmonaires qu’il finit par bloquer (ou l’une de ses branches). Résultat : une partie du poumon est lésée et n'oxygène plus le sang. Quant au cœur, il s’épuise progressivement à tenter d’envoyer du sang dans cette artère bouchée, jusqu'à s’arrêter de battre si le caillot est très important.
À noter, la « thrombose veineuse » est très différente de la « thrombose artérielle » qui n’a pas les mêmes conséquences (cf. Fiche Athérosclérose).
La phlébite et sa complication, l’embolie pulmonaire, sont deux formes d’une même pathologie : la maladie thrombo-embolique veineuse (MTEV). Les facteurs de risque de la MTEV sont bien connus. L’âge joue un rôle important. Pour le reste, il s’agit de facteurs qui influencent la coagulation et la circulation sanguine. On peut ainsi citer :
La paraphlébite survient généralement au niveau d’une varice qui peut devenir rouge, dure et douloureuse.
La phlébite profonde est caractérisée par une lourdeur et une douleur dans la jambe, un gonflement et une éventuelle coloration bleutée de la peau.
Sa complication, l’embolie pulmonaire, se manifeste par un essoufflement, des palpitations, des douleurs thoraciques, une toux irritative (avec parfois crachat sanglant) et des malaises.
Le diagnostic d’une paraphlébite peut être établi par l’examen clinique. La réalisation d'un écho-doppler peut être proposée afin de s’assurer de l’absence de phlébite profonde.
Lorsqu'une phlébite ou une embolie pulmonaire sont suspectées, un dosage sanguin des D-dimères, produits de la dégradation naturelle du caillot sanguin, est réalisé. Si le dosage est négatif, cela exclut tout événement thrombo-embolique. S’il est positif, un examen d'imagerie médicale est proposé pour confirmer le diagnostic : l'écho-doppler permet de visualiser le caillot dans une veine (phlébite) alors que l’angio - scanner sert à déceler le caillot dans une artère pulmonaire (embolie).
La réalisation d’une échographie cardiaque permet d’évaluer la gravité de l’embolie pulmonaire en appréciant les conséquences sur les cavités cardiaques.
En parallèle, un bilan sanguin est réalisé pour dépister d'éventuels facteurs génétiques impliqués dans la MTEV.
Lorsque l’artère pulmonaire est partiellement bouchée ou lors d'une phlébite dans un membre, on procède à un traitement dit « d’attaque » : pendant quelques jours, des injections sous la peau d'un anticoagulant, l’héparine, vont dissoudre progressivement le caillot.
Les formes les plus graves d’embolie pulmonaire, dans lesquelles l’artère pulmonaire est très obstruée, constituent une urgence vitale. Il faut alors déboucher au plus vite l’artère. Deux techniques sont alors envisageables : la thrombolyse (injection d’un médicament puissant qui vise à dissoudre rapidement le caillot sanguin) et la thrombectomie (ablation du caillot par voie chirurgicale ou en utilisant un cathéter).
Dans tous les cas, un traitement de fond, par anticoagulants oraux directs (AOD), est prescrit. En fonction de la gravité de la maladie et des traitements initiaux, les AOD sont démarrés d’emblée ou après quelques jours. Apparues récemment, ces molécules inhibent un facteur clé de la coagulation sanguine, empêchant la formation de caillot. Leur action est immédiate et leur efficacité ne varie pas d’un patient à l’autre. Aucune surveillance n’est nécessaire par bilan sanguin, ce qui facilite énormément la prise en charge. En cas de contre-indications (grossesse, antiphospholipides, etc.), des anticoagulants de type anti-vitamine K (AVK) par voie orale, peuvent être employés. Ils empêchent indirectement la synthèse de plusieurs facteurs de coagulation. Mais leurs effets varient selon les patients et plusieurs semaines sont nécessaires pour ajuster le traitement. Des bilans sanguins réguliers sont indispensables pour vérifier les paramètres de coagulation. Par ailleurs, ces AVK voient leur efficacité fluctuer s'ils sont associés à d’autres médicaments type anti-inflammatoires ou antalgiques.
Le port de chaussettes de compression veineuse (bas de contention) est généralement recommandé dès que possible, après diagnostic de phlébite.
Le traitement est adapté, en fonction du patient, notamment s’il est atteint de cancer ou si une grossesse est en cours.
Les recherches actuelles sont toutes tournées vers un but : personnaliser la prise en charge de la pathologie.
Les traitements actuels de la MTEV passent par l'utilisation d'anticoagulants. Aujourd’hui, il est difficile d'évaluer le temps durant lequel les patients doivent les prendre : le traitement ne fait que repousser la récidive et dès qu’on l’arrête, le risque revient. Ces molécules ne peuvent toutefois pas être prises à vie car leurs effets secondaires sont importants (en fluidifiant le sang, le traitement augmente le risque d’hémorragie). L'un des objectifs actuels est donc de prévoir individuellement le risque de récidive afin d'éviter des traitements au long cours. Les chercheurs tentent d'identifier des marqueurs biologiques, par exemple des protéines particulières présentes dans le sang, qui permettraient d’ajuster le traitement pour chaque patient. Il s’agit également d’identifier les facteurs de risque héréditaires de MTEV ou de récidives. Cela permettrait de mieux comprendre la maladie et de mettre en place des mesures préventives. Autre axe de recherche en étroite corrélation avec ce phénomène : le développement de nouveaux anticoagulants ne majorant pas le risque d’hémorragie ou à l’élaboration de traitements hormonaux n’impactant pas le risque thrombo-embolique.
Enfin, l’avènement de l’intelligence artificielle pourrait aussi permettre de mieux prédire le risque de mortalité du patient, afin d’adapter la durée du traitement à ses besoins réels.
Newsletter
Restez informé(e) !
Abonnez-vous pour recevoir les actualités et communications de la FRM, les projets et découvertes sur toutes les maladies…
Avec la FRM, votre don est un espoir de guérison
Soutenez les projets de recherche les plus prometteurs.
Deux protéines clés dans le syndrome des antiphospholipides
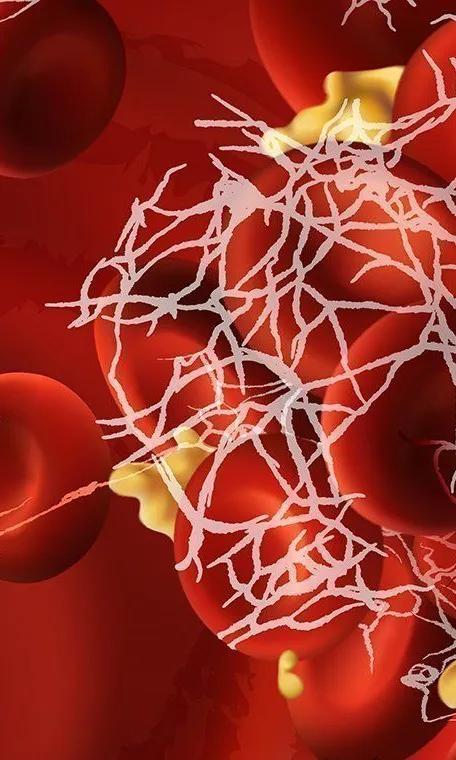
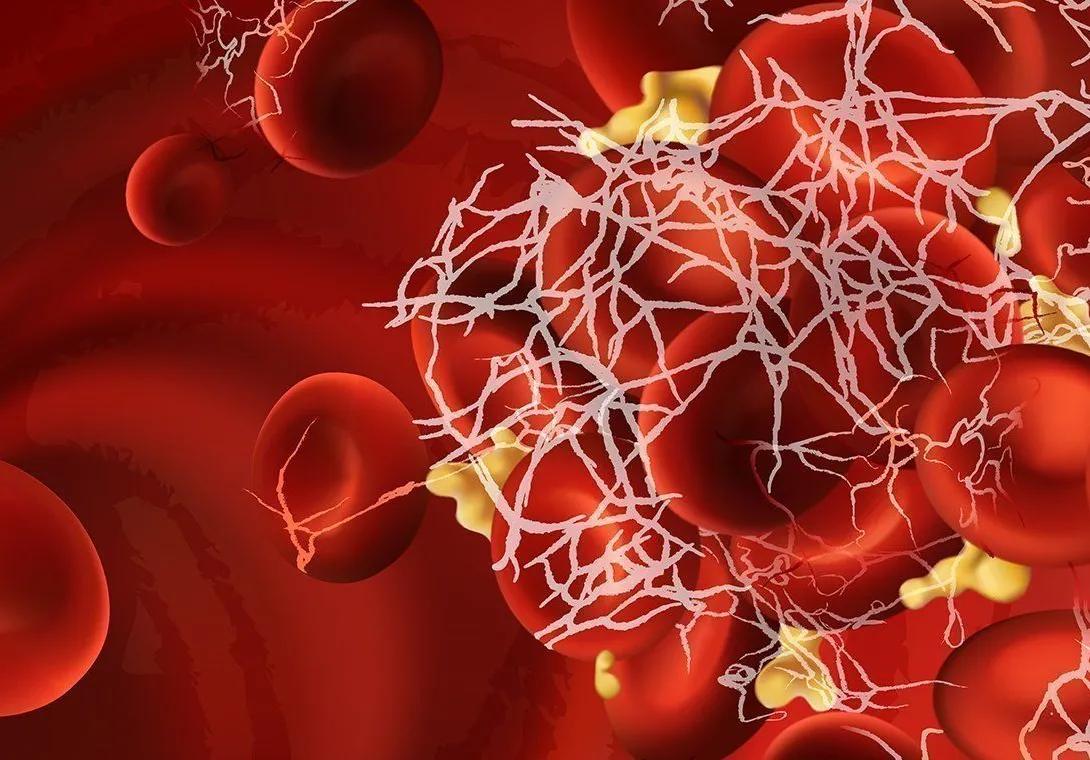
Maladies des vaisseaux : vers un traitement qui n’augmente pas le risque de thrombose veineuse après la ménopause
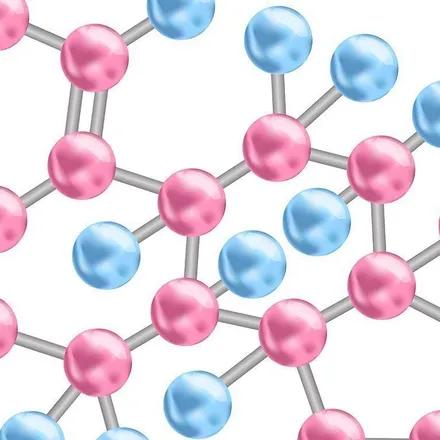
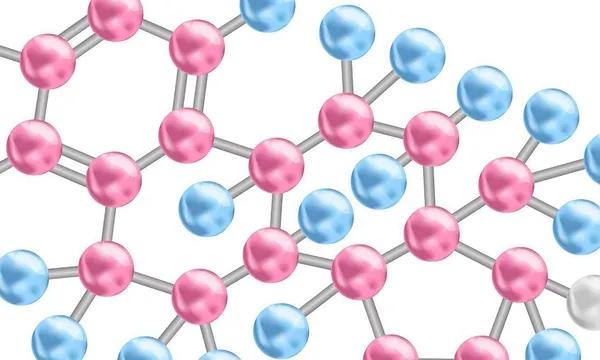
Maladie des vaisseaux : aux origines de la thrombose veineuse


Maladies cardiovasculaires
