VIH : une réponse immunitaire différente entre les hommes et les femmes
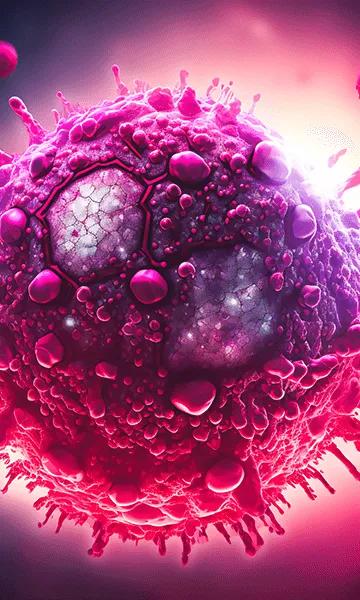
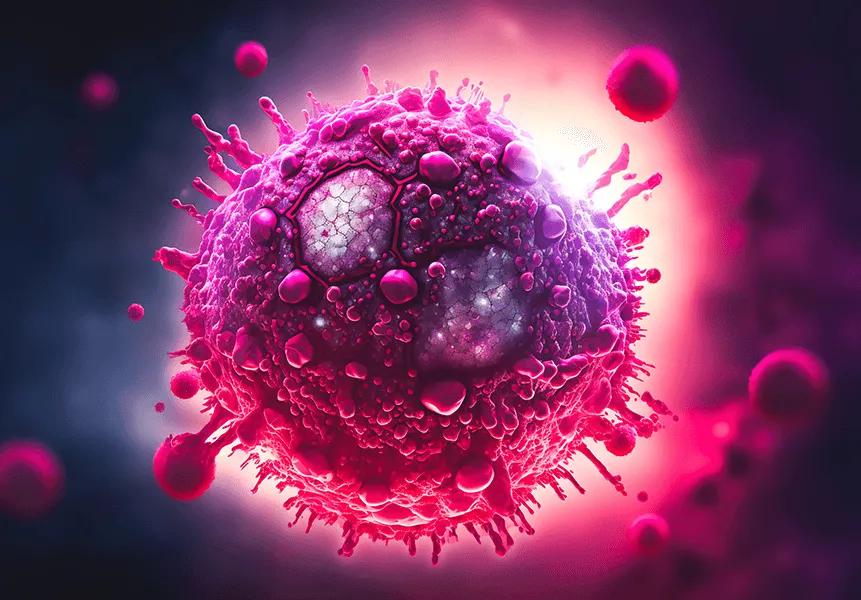
Découvert en 1983, le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) touche environ 40 millions de personnes dans le monde. Si aucun traitement ne permet actuellement de se débarrasser définitivement du virus, des traitements antirétroviraux efficaces permettent de stopper l’évolution de la maladie et de réduire sa contagiosité. Actuellement, le seul moyen de s’en prémunir est l’utilisation de moyens de protection et le dépistage. La recherche continue d’explorer de nombreuses pistes : traitements plus simples et accessibles, vaccins, etc.
Selon l'OMS, plus de 40 millions de personnes étaient porteuses du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) dans le monde fin 2024, dont 65 % dans la région africaine de l’OMS. En 2024, 1,5 million de personnes ont été infectées par le VIH.
En France, en 2022, on dénombrait environ 180 000 personnes infectées par le VIH (séropositives au VIH), et près de 5 000 personnes ont découvert leur séropositivité cette année-là.
Le sida est l’une des maladies infectieuses les plus mortelles. 630 000 personnes en sont décédées du sida en 2024 dans le monde (contre 1 million en 2016 et 2 millions en 2005). Depuis le début de l'épidémie, 85 millions de personnes ont été infectées par le VIH et plus de 40 millions de décès ont été liés au sida.
Deux types de VIH se distinguent actuellement : le VIH-1 et le VIH-2. Ces deux virus sont très proches. Le VIH-1 a été isolé en 1983, par l'équipe de Françoise Barré-Sinoussi et Luc Montagnier, découverte qui leur a valu le prix Nobel de médecine en 2008. C'est la forme du virus la plus répandue autour du globe. La forme VIH-2 a été isolée en 1986. Elle est moins pathogène que le VIH-1 : elle présente un risque de transmission plus faible et une évolutivité plus lente. Le VIH-2 est surtout présent en Afrique de l'Ouest.
La primo-infection constitue la phase initiale de l’infection par le VIH : le malade vient d’être contaminé, via le sang ou des liquides biologiques infectés par le VIH, et le virus envahit progressivement l’organisme. En quelques jours à quelques semaines, la personne contaminée commence à produire des anticorps dirigés contre le VIH. On parle alors de séroconversion : les tests de dépistage peuvent détecter la présence de ces anticorps, le patient est séropositif au VIH. L'infection peut être diagnostiquée.
De type rétrovirus, le VIH s'attaque alors aux cellules du système immunitaire, dont les lymphocytes T porteurs de la protéine CD4, et les détruit. Comme tout virus, le VIH se sert des éléments présents dans la cellule pour se reproduire : il injecte son matériel génétique dans le lymphocyte qui fabrique alors et assemble les différents constituants viraux. Au terme de ce cycle, les virus nouvellement formés ressortent du lymphocyte.
A ce stade, le virus se réplique rapidement, la charge virale (c’est-à-dire la quantité de virus présent dans le sang) augmente rapidement. La personne contaminée est très contagieuse, alors même qu’elle ne sait pas toujours qu’elle est infectée. La charge virale baisse légèrement ensuite pour se stabiliser, même sans traitement, à un « point de contrôle ».
L’infection se poursuit par une phase asymptomatique qui peut durer plusieurs années. Sans traitement, l’infection par le VIH détruit petit à petit la réserve de cellules immunitaires de l'organisme, ce qui le rend sensible aux infections opportunistes (pneumocystose pulmonaire, tuberculose, toxoplasmose cérébrale, candidose oesophagienne), voire aux cancer (la maladie de Kaposi, lymphomes non-hodgikiens). Lorsque le patient séropositif devient sensible à ces maladies ou que sa numération en CD4 descend en dessous de 200 par microlitre, le malade est atteint du sida, le syndrome d’immunodéficience acquise, la phase terminale de la maladie.
Le VIH se transmet par les liquides biologiques infectés (sang, lait maternel, sperme, sécrétions vaginales).
On distingue trois modes de transmission possibles du sida :
La voie sexuelle : lors de rapports sexuels non protégés ou de contacts bucco-génitaux avec une personne malade. La meilleure protection existante pour éviter un tel type de contamination reste le port du préservatif.
La voie sanguine : la pathologie peut se contracter lors d'une transfusion sanguine avec du sang contaminé (en France, la recherche d'agents transmissibles comme le VIH est systématiquement réalisée chez les donneurs de sang, ce qui rend ce cas de figure quasi impossible). Ce mode de transmission peut également se faire via le partage d'aiguilles et de seringues (consommation de drogues) ou d'instruments coupants infectés.
La voie maternelle : lors de l'accouchement ou de l'allaitement au sein, une mère atteinte du VIH peut contaminer son enfant. Le taux de transmission par ce biais a chuté drastiquement depuis l'apparition des traitements antirétroviraux.
Le temps de latence entre l'infection et le développement du sida peut empêcher une prise en charge précoce de la pathologie. Des tests de dépistage existent afin de détecter la présence du VIH dans le sang et donc authentifier l'infection.
Le test « classique » (test Elisa de 4e génération) est réalisé avec ou sans prescription médicale en laboratoire ou en centre de dépistage (CeGIDD, pour les personnes souhaitant restées anonymes) à partir d'une prise de sang. Il sera fiable s'il est réalisé 6 semaines après la conduite à risque (rapport sexuel sans protection, échanges de seringues, etc.). Les résultats sont donnés au bout de quelques jours. Si le test est positif, il sera confirmé par une autre méthode diagnostic, le test Western-Blot. Si l’infection est confirmée, le patient sera orienté vers un professionnel de santé pour le suivi médical.
Depuis quelques années, il est également possible d'avoir recours au « test rapide d'orientation diagnostic » (TROD) ou à un autotest de dépistage d’infection par le VIH. Ils sont réalisés à partir d'une goutte de sang prélevée au bout du doigt et donnent une réponse en quelques minutes. Ce test est considéré comme fiable s'il est pratiqué au moins 3 mois après l'infection. En cas de résultat positif, ce test doit obligatoirement être confirmé par le test « classique ».
Le diagnostic du sida est posé quand le patient présente une numération en CD4 inférieure à 200 par microlitre de sang (contre 500 à 1000 pour une personne saine) ou quand une ou plusieurs maladies opportunistes se sont développées.
Aux premiers stades de l'infection, les malades ne présentent pas de symptômes. Le délai avant leur apparition est variable d'une personne à l'autre, de 5 à 15 ans, voire parfois plus. De légers symptômes (fièvre, éruptions cutanés, articulations douloureuses, etc.) peuvent apparaître au moment de la séroconversion, c’est-à-dire au moment où l’organisme commence à produire des anticorps contre le VIH, un à deux mois après l’infection.
Il existe ensuite une période durant laquelle l'infection est « contenue » par le système immunitaire. Lorsque le nombre de lymphocytes baisse, des premières manifestations apparaissent telles que des candidoses, une diarrhée chronique, une fièvre, une perte de poids. Le syndrome d'immunodéficience acquise (sida) s'installe quand le système immunitaire est débordé. Les personnes sont alors sujettes aux infections opportunistes (tuberculose, pneumopathies, zona ou autres infections portées par des bactéries, champignons ou parasites) ainsi qu'à certains cancers. Parmi ces derniers, on peut citer la maladie de Kaposi (tumeurs cutanées dues à une forme du virus de l'herpès), les lymphomes non-hodgkiniens (cancers du système immunitaire) ou le cancer du col utérin.
Selon l’OMS, certaines pratiques et certaines situations augmentent le risque de contracter le VIH, notamment :
Plusieurs moyens de prévention permettent de réduire le risque de contamination, notamment l’usage du préservatif (masculin ou féminin), le dépistage régulier pour les personnes exposées et le recours à du matériel d’injection stérile.
Certains traitements permettent aussi de réduire le risque de contamination :
Les médecins disposent aujourd'hui d'un arsenal thérapeutique conséquent pour lutter contre la maladie. Ces traitements ont permis une grande amélioration de la qualité et de l'espérance de vie des patients, au prix d'effets secondaires parfois importants. Malheureusement, le sida reste toujours une maladie incurable.
Il existe plusieurs types de médicaments anti-VIH, chacun agissant au niveau d'une protéine particulière dont a besoin le virus pour se reproduire. Ainsi, certains bloquent l'entrée du virus dans la cellule hôte, d'autres empêchent la multiplication de son matériel génétique ou encore altèrent sa fabrication pour empêcher sa propagation.
Aujourd'hui, le traitement fait intervenir au moins 3 classes de médicaments (trithérapie) pour éviter les résistances et augmenter son efficacité. Ces derniers ont maintenant tendance à être regroupés au sein d'un seul et même comprimé afin d'en faciliter la prise et l'observance. Il est recommandé de débuter la thérapie le plus tôt possible après l’infection. Le traitement permet également de limiter le risque de transmission du virus au fœtus pour les femmes enceintes.
Des dosages sanguins (charge virale, numération CD4) peuvent être réalisés afin de vérifier l’évolution de la maladie. D’autres examens peuvent être recommandés afin de rechercher d’autres infections associées au VIH. Dans certains cas, des traitements pouvant prévenir les maladies opportunistes pourront être prescrits. La vaccination contre certaines pathologies peut aussi être préconisée.
Les personnes séronégatives à risque d’exposition peuvent bénéficier d’un traitement antirétroviral de prophylaxie pré-exposition (PrEP). Sont particulièrement concernés les hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes, les hommes et femmes trans, les personnes en situation de prostitution, les personnes originaires de régions où le VIH est très présent, les usagers de drogues injectables, les personnes ayant des partenaires multiples. Celui-ci permet de réduire le risque de contamination. Un nouveau traitement à la durée d’action plus longue (le lenacapavir) pourrait changer la thérapie préventive en offrant une protection en seulement deux prises par an.
Réservé aux situations d’urgence, le traitement post-exposition (TPE), à base d’antirétroviraux, peut être prescrit en milieu hospitalier, dans les CeGIDD ou centres de santé sexuelle d’approche communautaire (CSSAC). Il doit être pris rapidement (de préférence dans les 4 heures après l’exposition, 48 heures maximum) pendant 30 jours. Il réduit le risque de contamination mais n’élimine pas totalement le risque.
Les personnes séropositives peuvent également prendre un traitement pour limiter le risque de transmission : le TASP (traitement comme prévention) ou le PTME (prévention de la transmission mère-enfant).
Les recherches restent très actives sur tous les fronts pour combattre le virus.
Du côté de la recherche fondamentale, les scientifiques s’affairent à trouver de nouveaux médicaments anti-VIH, pour améliorer leur efficacité, leur durée d’action ou encore faciliter leur accès. Ils tentent également de mieux comprendre les mécanismes sous-jacents au développement de l’infection, par exemple pourquoi hommes et femmes réagissent différemment ou comment le virus arrive à « se cacher » dans l’organisme. Des chercheurs ont également découvert que certaines personnes étaient résistantes à l’infection (naturellement ou après arrêt du traitement) et tentent de comprendre quels sont les mécanismes sous-jacents. Plus étonnant, des médecins ont observé trois cas de « guérison » : des patients infectés par le VIH qui, 8 mois après une greffe de moelle effectuée pour traiter une autre maladie, présentaient un taux de virus indétectable dans le sang. Ils cherchent actuellement à reproduire ce résultat par d’autres moyens, afin de le rendre reproductible et accessible à large échelle.
Du point de vue de la prévention, la mise à disposition récente d’un traitement préventif offrant une protection en seulement deux injections par an a relancé l’espoir de mettre au point un vaccin contre le VIH. Les scientifiques ont aussi mis en évidence les effets bénéfiques de la circoncision dans la réduction du risque d'être infecté chez l'homme. Les raisons physiologiques exactes de cette protection restent encore mal comprises, mais des recherches sont menées pour expliquer cette observation. Une des hypothèses est que l'ablation du prépuce induit un épaississement de la muqueuse qui pourrait former une sorte de barrière contre le virus. Ces résultats devraient entraîner la mise en œuvre de programmes de circoncision volontaire sur le continent africain.
Autant de nouveautés qui laissent présager des améliorations de la prise en charge de la maladie dans les années à venir.
Newsletter
Restez informé(e) !
Abonnez-vous pour recevoir les actualités et communications de la FRM, les projets et découvertes sur toutes les maladies…
Avec la FRM, votre don est un espoir de guérison
Soutenez les projets de recherche les plus prometteurs.
VIH : une réponse immunitaire différente entre les hommes et les femmes
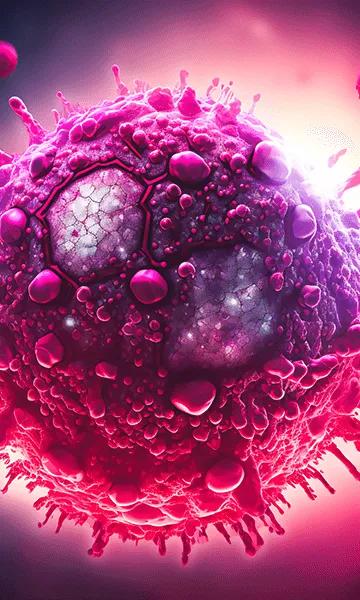
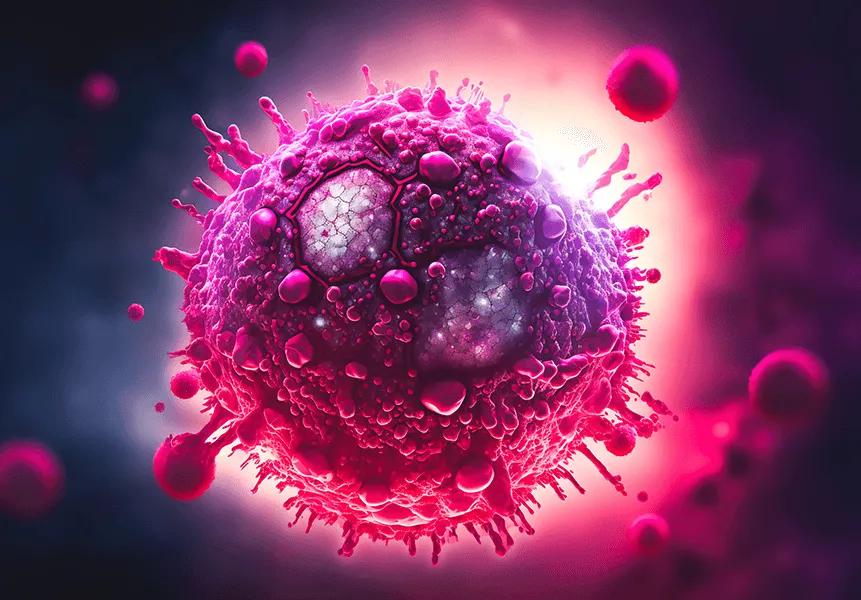
Découverte d’une protéine marqueur des cellules réservoirs du VIH
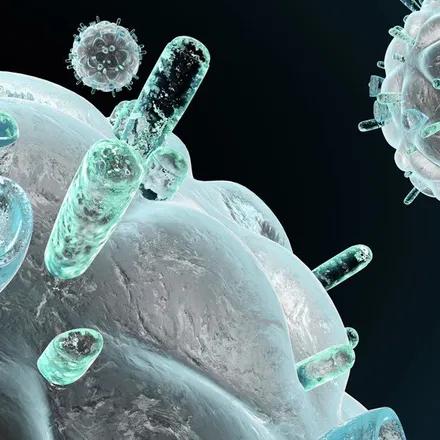
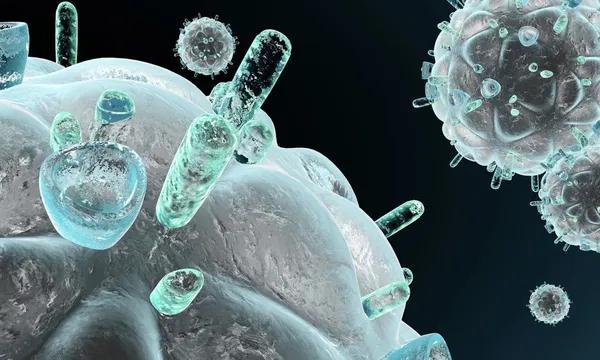
Sida : mise en évidence d’une voie moléculaire centrale dans l’assemblage du virus


Maladies infectieuses
