Hépatite C : quels sont les facteurs génétiques prédisposant aux complications hépatiques liées à l’hépatite C


L’hépatite C est une infection virale touchant 50 millions de personnes à travers le monde. Silencieuse pendant de nombreuses années, cette maladie détruit progressivement les cellules hépatiques, pouvant causer de graves complications, tels la cirrhose ou le cancer du foie. Si aucun vaccin n’existe aujourd’hui, les antiviraux d’action directe pangénotypiques développés récemment montrent une efficacité exceptionnelle. Le manque de dépistage et le coût de ces traitements restent toutefois un frein pour atteindre une éradication complète de la maladie.
Selon l’Organisation mondiale de la santé, en 2022, 50 millions de personnes étaient porteurs chroniques de l’hépatite C à travers le monde et près de 242 000 décès étaient imputables à cette maladie, pour la plupart suite à une cirrhose ou un carcinome hépatocellulaire (cancer primitif du foie). L’OMS estime par ailleurs qu’un million de nouvelles contaminations surviennent chaque année dans le monde.
En France, l’Inserm estime que moins de 200 000 personnes vivent avec une infection chronique au virus de l’hépatite C (VHC). Ce nombre a fortement chuté ces dernières années (232 000 en 2011, 193 000 en 2016, 134 000 cas en 2021), en raison de l’apparition de traitements très efficaces.
En 2016, l’OMS s’est fixé comme objectif d’éliminer les hépatites virales, d’ici 2030, c’est-à-dire de réduire les nouvelles infections de 90 % et la mortalité de 65 %, par rapport à 2015.
A l’échelle mondiale, la lutte contre l’hépatite C se heurte toutefois à l’accès limité aux tests diagnostics et aux traitements. En 2022, l’OMS a estimé que seuls 36 % des porteurs de la maladie étaient diagnostiqués. Et parmi les patients reconnus comme étant porteurs d’une forme chronique de la maladie, seuls 20 % avaient reçu un traitement. Résultat : malgré l’avancée du diagnostic et du dépistage, le nombre de décès liés aux hépatites virales est en augmentation dans le monde. Ces maladies constituent la deuxième cause de décès par maladie infectieuse à l’échelle mondiale.
L'hépatite C est une maladie infectieuse provoquée par le virus de l'hépatite C, ou VHC. Comme son nom l'indique, elle se caractérise par une inflammation hépatique : le virus atteint les cellules du foie, les hépatocytes, les infecte, puis s'y multiplie activement, induisant la mort des cellules.
Dans un tiers des cas, les personnes infectées se débarrassent spontanément du virus. Pour les autres, la maladie reste dans l’organisme, souvent silencieusement, pendant de nombreuses années. Si l'infection devient chronique, l'hépatite C peut provoquer l'apparition d'une fibrose, un tissu cicatriciel prenant la place des cellules du foie, et dont le stade ultime est la cirrhose du foie.
La multiplication du virus dans d’autres tissus peut aussi être à l’origine d’ une inflammation anormale d’autres organes, et des manifestations extra-hépatiques peuvent ainsi apparaître.
Après une longue évolution - de plusieurs décennies parfois -, l’atteinte hépatique provoque des complications. Peu à peu, le foie ne peut plus assurer son rôle. Une cirrhose du foie peut apparaître et peut conduire in fine au développement d’un cancer du foie.
Selon l’Assurance maladie, 15 à 30 % des hépatites C évoluent vers une cirrhose. Le risque d’évolution vers la cirrhose ou le cancer est majoré par certains facteurs de risque, tels la co-infection par le VIH et / ou le VHB, la dépendance à l’alcool et le surpoids.
Le virus de l'hépatite C se transmet principalement par le sang. La contamination résulte le plus communément d'un partage de matériel contaminé lors de la consommation de drogues (seringues non stériles) ou lors d’actes médicaux non sécurisés (transfusions de sang n’ayant pas fait l’objet d’un dépistage, mauvaise gestion des déchets médicaux par exemple). Dans les pays développés, le risque de transmission lors d’actes médicaux a grandement diminué grâce aux contrôles mis en place lors des transfusions sanguines.
Le virus peut également être transmis au cours de rapports sexuels non protégés, ou de la mère à l'enfant lors d'un accouchement, mais ces deux cas restent marginaux.
Environ un tiers des patients guérit spontanément, dans les six mois. Chez les deux tiers restants (55 à 85 % des patients), la maladie évolue vers une forme chronique.
En phase « aiguë », c’est-à-dire deux semaines à six mois après le début de l’infection virale, les symptômes sont discrets voire inexistants. Ils se traduisent principalement par une fatigue et une jaunisse (ictère) caractérisée une coloration jaune de la peau et blanche des yeux reflétant l’atteinte du foie. Des urines foncées, des selles blanchâtres peuvent également être observées. De même, qu’une fièvre, une perte d’appétit, des nausées et vomissements, des douleurs abdominales et articulaires.
Exceptionnellement (moins de 1 % des cas), l’hépatite aiguë est « fulminante », le foie est alors rapidement endommagé et une transplantation hépatique est nécessaire en urgence.
Lorsque le système immunitaire n’est pas parvenu à se débarrasser du virus après six mois, l’infection entre en phase chronique. Les symptômes sont des douleurs abdominales, du sang dans les selles et des vomissements, du liquide dans l’abdomen (ascite) et l’ictère. Ces symptômes sont légers et peu spécifiques, si bien que la maladie peut passer inaperçue pendant des années.
La prolifération anormale de grandes quantités d’anticorps dans différents organes et l’inflammation associée sont à l’origine de symptômes sans lien, a priori, avec l’atteinte hépatique. Il s’agit notamment de cryoglobulinémies mixtes, découlant de l’inflammation des vaisseaux sanguins (vascularite). Celle-ci est associée à une fatigue chronique, un syndrome de Sjögren (bouche et yeux secs), atteinte rénale, lymphoprolifération, des manifestations cutanées (tâches, marbrures rouges ou violettes, plaques de boutons, hypersensibilité à la lumière ou au soleil), douleurs articulaires, nerveuses, musculaires, et rénales. D’autres pathologies associées peuvent apparaître, telles qu'une insulinorésistance ou un lymphome.
La fibrose hépatique peut évoluer en cirrhose, caractérisée par la présence d’hémorragies du tube digestif (liées à des varices dans l’œsophage), d’ascite (liquide dans l’abdomen), et d’œdèmes. La maladie peut également évoluer vers un cancer du foie.
Le diagnostic précoce permet de limiter les effets délétères de la maladie et la transmission du virus. L’OMS recommande le dépistage pour toutes les personnes à risque, comme les usagers de drogues, les personnes détenues en milieux fermées, les hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes, les travailleurs du sexe ou les personnes infectées par le VIH.
Dans un premier temps, la recherche d’une infection par le virus de l'hépatite C est réalisée via un test sanguin. Il est basé sur la détection de certaines molécules sécrétées par le système immunitaire (les anticorps anti-VHC) ; leur présence reflète une lutte de l'organisme contre le pathogène. En cas de positivité, le laboratoire procède à un second examen sur le même échantillon afin de distinguer une infection ancienne, guérie par l’organisme, d'une atteinte actuelle (caractérisée par la présence de l’ARN du VHC) nécessitant une prise en charge. A noter que les centres de dépistage proposent des tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) qui recherchent uniquement la présence d’anticorps anti-VHC, c’est-à-dire un contact (récent ou ancien) avec le virus. En cas de positivité, le diagnostic doit être confirmé par un test de dépistage en laboratoire d’analyse.
Si le test sanguin est positif, les médecins évaluent ensuite le degré d'atteinte du foie à l'aide d’un dosage des transaminases, des enzymes hépatiques. Leur taux sanguin augmente proportionnellement à la gravité des lésions du foie. Une échographie hépatique et des biopsies du foie (prélèvement de cellules hépatiques) peuvent également être réalisées afin d'évaluer la progression de la fibrose. Des comorbidités, telles une hépatite B et / ou D, un VIH, un diabète, un cholestérol ou une maladie rénale sévère peuvent être recherchées.
Il y a une dizaine d’années, de nouvelles thérapies ont vu le jour : les antiviraux d’action directe (AAD). Ces molécules sont capables de s’attaquer directement aux virus pour les détruire, et ce, avec moins d’effets secondaires que le traitement précédent. Leur taux d'efficacité est très impressionnant : l’Inserm a estimé qu’ils permettaient d’atteindre 90 à 95 % de guérison. Une véritable révolution ! Ce traitement doit être pris pendant 12 à 24 semaines, en fonction de la sévérité de l’atteinte hépatique et des comorbidités associées. En 2017, l’arrivée des traitements pangénotypiques (c’est-à-dire efficaces sur l’ensemble des six souches de virus), avec des durées de traitement plus courtes, a encore amélioré la prise en charge : ces médicaments doivent être pris pendant 12 semaines seulement, et la HAS estime que 98 % des patients guérissent.
En France, les AAD pangénotypiques sont pris en charge à 100 % par l’Assurance maladie, sur prescription du médecin généraliste. Mais l’accès au traitement reste encore limité dans d’autres pays, en raison d’un dépistage insuffisant et du coût des traitements.
Contrairement aux hépatites de type A ou B, il n’existe pas de vaccin contre l’hépatite C.
C'est pourquoi un grand pan de la recherche s’attache à développer des vaccins contre cette maladie. Les chercheurs souhaitent actuellement élaborer un vaccin dit « bivalent », qui protégerait à la fois contre l’hépatite B et l’hépatite C. Il pourrait constituer un espoir pour les pays de forte endémie pour les deux pathologies.
Une meilleure connaissance du virus et de ses résistances constitue également un objectif de la recherche actuelle. Ainsi, les chercheurs s'intéressent aux mécanismes moléculaires de la multiplication virale dans les hépatocytes, en vue de trouver de nouvelles cibles thérapeutiques exploitables dans la maladie. Ils cherchent également à comprendre les mécanismes impliqués dans le développement de la cirrhose ou le cancer pour contrer cette évolution. La maladie restant longtemps silencieuse, les chercheurs tentent aussi de déterminer les facteurs de risque de complications de la maladie, tels la vascularite, la cirrhose ou le cancer.
En outre, les politiques de santé s'attachent à une amélioration du dépistage de la maladie, puisque seuls 36 % des personnes en phase chronique à l’échelle mondiale savent qu’ils sont malades (environ 80 % des malades connaissaient leur infection en France, en 2016). La recherche tente notamment d’élaborer un test diagnostic plus rapide et abordable adapté aux pays pauvres où l’endémie de la maladie est forte.
Autant d’efforts à fournir pour que l’hépatite C ne soit plus qu'un mauvais souvenir.
Newsletter
Restez informé(e) !
Abonnez-vous pour recevoir les actualités et communications de la FRM, les projets et découvertes sur toutes les maladies..
Avec la FRM, votre don est un espoir de guérison
Soutenez les projets de recherche les plus prometteurs.
Hépatite C : quels sont les facteurs génétiques prédisposant aux complications hépatiques liées à l’hépatite C


Hépatite C : mieux prendre en charge les vascularites cryoglobulinémiques
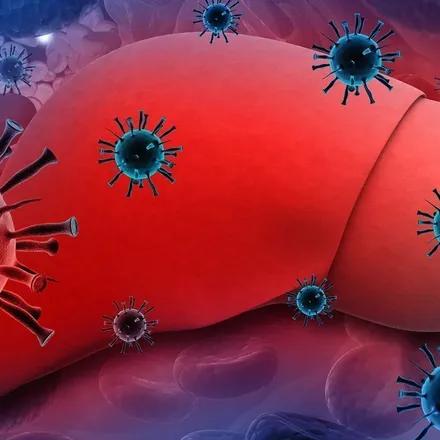
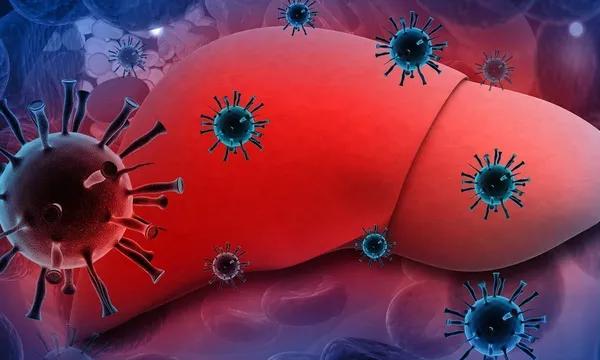
Hépatite C : découverte d’un nouveau mécanisme d’action d’une molécule antivirale
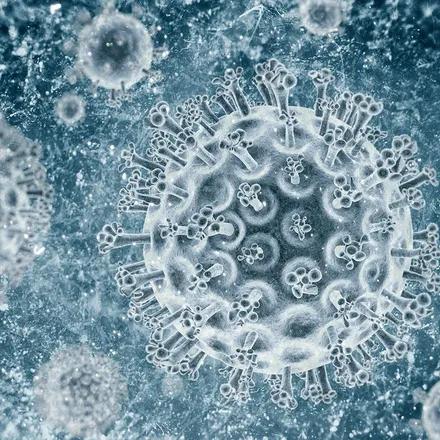
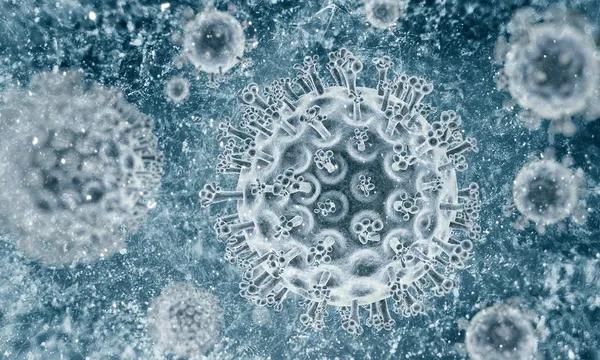
Maladies infectieuses
