Troubles du rythme cardiaque : un peptide prometteur pour la prise en charge des dysfonctions du nœud sinusal


Tachycardie, bradycardie, fibrillation … Les troubles du rythme cardiaque prennent de nombreuses formes. Si plusieurs symptômes (palpitations, essoufflement, fatigue, etc.) peuvent alerter, certains patients restent asymptomatiques et seul un ECG permettra de mettre à jour une arythmie. Mesures hygiéno-diététiques, anti-arythmiques, chirurgie, voire pose d’un pacemaker permettent aujourd’hui aux patients de limiter les complications. La recherche progresse aussi dans le dépistage de ces anomalies, dont la prévalence devrait encore doubler d’ici 2060.
En 2023, 2,7 millions de Français avaient déjà été hospitalisés pour un trouble majeur du rythme cardiaque. Parmi eux, plus de 2 millions pour une fibrillation ou un flutter auriculaire, et 215 000 pour une tachycardie ventriculaire ou un arrêt cardiaque.
Sur la seule année 2022, 90 500 hospitalisations ont concerné un fibrillation ou flutter atrial, et 16 900 une tachycardie ventriculaire ou un arrêt cardiaque, soit 169,5 et 31,7 cas pour 100 000 habitants.
La fibrillation atriale (ou fibrillation auriculaire) est le plus fréquent des troubles du rythme cardiaque. Elle touche plus de 600 000 Français et environ 60 millions de personnes à travers le monde. En 50 ans, la prévalence de cette anomalie a quadruplé. En cause : le vieillissement de la population et la hausse des facteurs de risque. Et cette tendance ne devrait pas s’inverser : dans une étude parue en 2013 dans l’European Heart Journal, des chercheurs ont estimé que la fibrillation atriale pourrait encore doubler entre 2010 et 2060.
Le cœur est une pompe composée de quatre cavités : deux oreillettes recevant le sang et deux ventricules le propulsant dans la circulation, à une fréquence régulière. Ce rythme cardiaque est régi par des impulsions électriques périodiques qui traversent le cœur, et permettent une contraction synchrone de ces structures. Ce courant électrique naît au niveau du nœud sinusal, un ensemble de cellules situé au niveau de l'oreillette droite. C'est le centre régulateur du rythme cardiaque, permettant d’assurer le fonctionnement normal du cœur. Une arythmie peut faire perdre la contraction synchrone des ventricules et entraîner une insuffisance cardiaque ou un arrêt cardiaque. Ce rythme imposé par le nœud sinusal est régulé par divers facteurs : système nerveux, hormones, substances circulant dans le sang.
Chez un adulte au repos, le rythme cardiaque est compris entre 50 et 100 pulsations par minute ; il varie d’un individu à l’autre. Il peut augmenter ou diminuer selon l’état d’activité, la température extérieure ou la prise de médicaments, de café…
Une arythmie ou trouble du rythme cardiaque correspond à une variation du rythme cardiaque sans raison apparente. À plus de 100 battements par minute au repos, on parle de tachycardie ; en dessous de 50 battements par minute, de bradycardie ; et si les contractions sont irrégulières, on parle d’arythmie.
On parle de fibrillation lorsque les structures du cœur (oreillettes ou ventricules) se contractent de manière anarchique. Il s’agit d’un trouble du rythme dont les causes peuvent être cardiaques (comme une cardiopathie) ou non (prise de substances). On dénombre deux types de fibrillations :
La fibrillation auriculaire : c’est la plus fréquente des arythmies graves. Elle se traduit par des contractions irrégulières des oreillettes. Ces dernières ont du mal à assurer le remplissage des ventricules. Le sang a tendance à stagner, favorisant l’apparition de caillots qui peuvent à terme conduire à un accident vasculaire cérébral (AVC) s'ils passent dans la circulation. C’est également un facteur de risque d’insuffisance cardiaque, pathologie au cours de laquelle le cœur ne peut plus assurer son rôle de pompe. À noter l’existence d’une entité très proche de la fibrillation auriculaire : le flutter auriculaire, également potentiellement responsable d’insuffisance cardiaque et d’AVC.
La fibrillation ventriculaire : c’est la forme d’arythmie la plus grave. Les ventricules battent alors tellement vite (au-dessus de 250 fois par minute) qu'elles ne peuvent plus mécaniquement se contracter, réalisant ainsi l’équivalent d’un arrêt cardiaque. Si cette arythmie ne cesse pas rapidement, elle entraîne la mort en quelques minutes (« mort subite »). Une tachycardie ventriculaire peut parfois précéder la fibrillation ventriculaire, notamment chez les patients présentant une altération marquée du cœur.
Les extrasystoles : des cellules distinctes de celles du nœud sinusal génèrent une impulsion électrique. Le cœur bat alors prématurément, puis fait une pause avant de reprendre son activité normale. On parle d’extrasystole auriculaire lorsque l’oreillette est touchée, ou ventriculaire quand les ventricules sont en jeu.
La bradycardie correspond à une diminution du rythme cardiaque au repos, en dessous de 50 battements par minute. Si elle peut être naturelle chez les grands sportifs, elle peut être liée à une affection des cellules du nœud sinusal ou résulter d'un problème de transmission de l'impulsion électrique entre les structures du cœur (« bloc auriculo-ventriculaire »).
La tachycardie correspond à un rythme de plus de 100 battements par minute au repos. Cette arythmie peut être bénignes ou résulter d’une fibrillation.
Avec l’avancée en âge, certaines cellules musculaires cardiaques disparaissent et sont remplacées par du tissu fibreux incapable de transmettre l’influx électrique à l’origine de la contraction du coeur. Si le tissu fibreux devient trop important, un trouble du rythme cardiaque peut apparaître. Ainsi, l’âge est un facteur de risque de troubles du rythme cardiaque.
Certaines maladies, telles les infections, certaines anomalies génétiques ou des cardiopathies, peuvent également accélérer le processus de fibrose et favoriser l’apparition d’arythmie. Parmi les cardiopathies favorisant l’apparition d’un trouble du rythme cardiaque, on peut noter la maladie coronaire, un récent infarctus du myocarde, une valvulopathie ou une hypertension artérielle. Certaines maladies endocriniennes, telles l’hypo- ou l’hyperthyroïdie, ou l’apnée du sommeil ont aussi été associées à un risque accru de troubles du rythme cardiaque.
A l’inverse, la marche régulière à allure moyenne, avoir une alimentation équilibrée et limiter les excitants protège contre le risque de développer une arythmie cardiaque.
Les troubles du rythme cardiaque sont des pathologies fréquentes. Leur nombre est en constante augmentation du fait notamment d’un vieillissement de la population et d'une amélioration des moyens de dépistage.
Parmi ces troubles, la fibrillation auriculaire (ou atriale) est la plus répandue : l'Assurance maladie estime qu’elle concerne environ 1 % de la population générale, et 10 % des plus de 80 ans. Cette anomalie du rythme cardiaque représente un véritable problème, car elle augmente le risque d’accident vasculaire cérébral (AVC) et d'insuffisance cardiaque : toujours selon l'Assurance Maladie, on estime que 20 à 30 % des AVC seraient liés à ce trouble.
Les troubles de rythme ont un retentissement direct sur la mortalité. Parfois, il n’existe pas de « signe annonciateur » à la maladie. Ainsi, en 2010 l'Académie de Médecine a évalué à 50 000 le nombre de décès par « mort subite » en France, 80 % des cas étant liés à un emballement extrême du rythme cardiaque appelé « fibrillation ventriculaire ».
Enfin, en ce qui concerne les bradycardies sévères, d’après les données rapportées par la Fédération française de cardiologie, « le nombre d’implantations de pacemaker est en constante augmentation depuis ces dernières années. En 2007, on dénombrait 61 315 personnes ayant bénéficié d'une implantation d’un stimulateur cardiaque et 67 834 en 2015 » Et environ 75 000, aujourd’hui.
Dans certains cas, le patient ressent des palpitations, c’est-à-dire sentir des battements cardiaques intenses et anormalement rapides. Elles peuvent être ponctuelles et sans gravité. Mais si elles reviennent fréquemment et, notamment, à l’effort, elles peuvent être le signe d’une arythmie. A l’inverse, il peut ressentir des battements trop lents. D’autres symptômes, tels une fatigue, un étourdissement, des vertiges, une perte de connaissance (syncope) font partie des signes d’appels.
Dans d’autres cas, l’arythmie peut rester totalement asymptomatique. Seul l’électrocardiogramme permettra de la révéler.
Certaines montres connectées avec tracé ECG peuvent alerter sur une anomalie du rythme et doivent encourager le patient à aller consulter un spécialiste. Le dépistage précoce peut permettre de prévenir des complications associées aux troubles du rythme cardiaque, notamment la formation de caillots sanguins, l’AVC ou encore l’arrêt cardiaque.
Devant des symptômes évocateurs d’une arythmie, le praticien peut proposer plusieurs examens.
L'électrocardiogramme (ECG) permet d’observer la conduction du signal électrique cardiaque à l’aide d’électrodes placées sur la peau. Une de ses variantes est le holter ECG, consistant à enregistrer pendant plusieurs heures voire plusieurs jours la conduction cardiaque à l’aide d’un dispositif portatif. Il permet la détection d’arythmies transitoires, peu visibles lors d’un examen de courte durée.
Le test d’effort consiste en la réalisation d’un exercice intense dans le cabinet du cardiologue, qui permet de détecter des arythmies survenant à l’effort.
L'examen électrophysiologique : sous anesthésie locale, des sondes sont introduites dans une veine de la cuisse, puis remontées vers le cœur via un cathéter. Il permet de détecter, provoquer et analyser l’arythmie.
Des examens d’imagerie, comme l'échographie ou l’imagerie par résonance magnétique, peuvent compléter ces examens, à la recherche d’éventuelles complications cardiaques.
Un bilan sanguin peut être demandé à la recherche d’anomalies favorisant l’apparition d’un trouble du rythme (troubles thyroïdiens, anémie, hypocalcémie, hypokaliémie, etc.)
Lorsqu’une tachycardie bénigne est détectée, les médecins privilégient une approche hygiéno-diététique : arrêt des excitants de type café ou alcool, repos, activité physique …
Pour des atteintes plus graves, l’utilisation d’anti-arythmiques, tels que les bêtabloquants ou les inhibiteurs calciques, peut être nécessaire. Ces médicaments varient selon le type d’arythmie ou la réponse des patients. En cas de fibrillation auriculaire, des anticoagulants doivent aussi être prescrits pour éviter la formation de caillots sanguins.
En cas d’arythmies résistantes aux médicaments, il peut être proposé au patient de détruire chirurgicalement la zone cellulaire à l’origine du problème. Plusieurs techniques existent. La première est l’ablation par radiofréquence : la zone du cœur qui dysfonctionne est alors brûlée par un courant électrique à haute fréquence. La seconde est la cryoablation qui consiste à détruire les cellules à l’origine de l’arythmie par un froid intense pouvant atteindre -80°C. Depuis quelques mois, certains hôpitaux soignent la fibrillation atriale par électroporation (ablation par champ pulsé). Cette technique chirurgicale permet d’isoler les cellules cardiaques lésées responsables du trouble du rythme cardiaque, en perçant des trous microscopiques. Moins invasive, elle offrirait en outre de meilleurs résultats. Selon une récente publiée dans Nature medicine, l’intelligence artificielle pourrait aussi améliorer la détection précise des zones à traiter et améliorer l’efficacité de ces traitements.
Il n’existe à l’heure actuelle pas de traitement médicamenteux à prendre au long cours dans le cas de bradycardie avec un rythme cardiaque très lent : la pose d’un pacemaker (stimulateur cardiaque) est la seule thérapie disponible.
En cas de tachycardie ou de fibrillation, le praticien peut avoir recours au défibrillateur automatique implantable dans le cœur. Ce dispositif permet la détection automatique de toute variation du rythme cardiaque et déclenche un micro-choc électrique pour le ramener à la normale.
Enfin, en cas d’urgence de type fibrillation ventriculaire grave, on peut appliquer au cœur un choc électrique à l’extérieur du thorax en vue de rétablir un rythme cardiaque normal via un défibrillateur « externe ».
De nombreuses voies sont actuellement explorées dans la lutte contre les troubles du rythme cardiaque. Elles visent à améliorer la compréhension des mécanismes à l'origine des arythmies ainsi que leur prise en charge diagnostique et thérapeutique.
Il s'agit tout d’abord d'étudier les éléments qui sont impliqués dans la genèse des arythmies, au niveau cardiaque.
Des chercheurs français ont par exemple démontré le rôle du tissu graisseux autour du cœur et des oreillettes lors du développement de la fibrillation atriale. Ce tissu produit des molécules inflammatoires qui favorisent l’apparition de ce trouble. Ces molécules pourraient constituer un biomarqueur pertinent dans le dépistage de la fibrillation atriale et représenter une cible thérapeutique intéressante.
Autre avancée : chez les sujets présentant une fibrillation ventriculaire, il a été montré qu’une petite zone s’apparentant au tissu de conduction de l’impulsion électrique cardiaque, le Purkinje, pouvait être à l’origine de cette arythmie. Certaines équipes étudient actuellement les mécanismes en jeu afin de développer des thérapies adaptées aux spécificités de ce tissu et réduire le risque de mort subite qui en découle.
Une des voies majeures de recherche est la mise au point de moyens pour dépister des patients atteints d’arythmie asymptomatique. Il s’agit de repérer les personnes susceptibles de développer une fibrillation ventriculaire et pour qui, le plus souvent, la mort subite constitue l’unique élément révélateur de la pathologie. Une étude parue récemment dans l’European Heart Journal a montré que l’intelligence artificielle permettrait d’identifier les personnes à risque imminent d’arythmie ventriculaire (et donc d’infarctus), chez les patients asymptomatiques. Implémentés sur des appareils de contrôle existants, tels qu’un électrocardiogramme, ces algorithmes pourraient améliorer la prévention.
Le développement d'outils diagnostiques constitue un axe de recherche. Des chercheurs tentent d’identifier de nouvelles mutations génétiques impliquées dans les arythmies afin de les dépister et faciliter le diagnostic et le suivi. Des électrocardiogrammes « de longue durée » peuvent désormais être réalisés, à l’aide de dispositifs miniaturisés, appelés « holters implantables ». Ceux-ci peuvent être installés sous la peau et fonctionner pendant 2 à 3 ans pour déceler et analyser tout problème de rythme cardiaque. Le développement de bracelets ou montres connecté(e)s toujours plus perfectionné(e)s permet aussi de surveiller le rythme cardiaque. Mais attention, du fait de leur fiabilité parfois controversée, ils ne constituent qu’un complément aux techniques habituellement utilisées pour le suivi. Des chercheurs américains ont même développé des « tatouages médicaux » au graphène capables de détecter des arythmies.
La recherche tente de mettre au point de nouveaux traitements, mais aussi de perfectionner les techniques interventionnelles pour les rendre à la fois plus efficaces et plus sûres. Des nouveaux pacemakers capables de supplanter des troubles du rythme de plus en plus complexes ont été mis au point. Des chercheurs ont même imaginé des pacemakers implantables temporaires, qui se dissolvent, et peuvent soutenir le cœur après une opération par exemple.
Ainsi, la recherche avance sur différents axes afin que tous les patients puissent disposer d'un traitement « à la carte », spécifique à son trouble du rythme.
Newsletter
Restez informé(e) !
Abonnez-vous pour recevoir les actualités et communications de la FRM, les projets et découvertes sur toutes les maladies…
Avec la FRM, votre don est un espoir de guérison
Soutenez les projets de recherche les plus prometteurs.
Troubles du rythme cardiaque : un peptide prometteur pour la prise en charge des dysfonctions du nœud sinusal


Arythmies : explorer les mécanismes en jeu dans la fibrillation ventriculaire


Troubles du rythme cardiaque : un risque de fibrillation auriculaire augmenté après la perte d’un conjoint
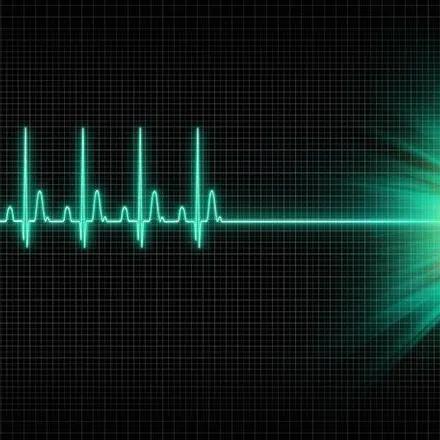
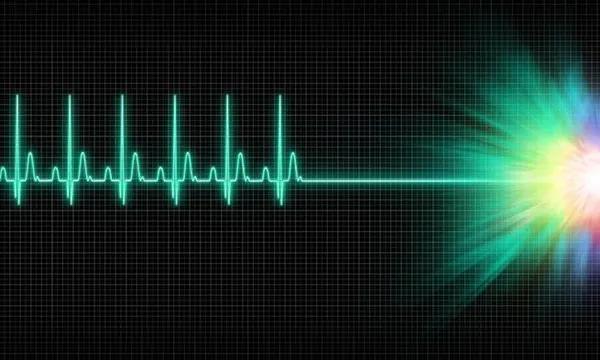
Maladies cardiovasculaires
